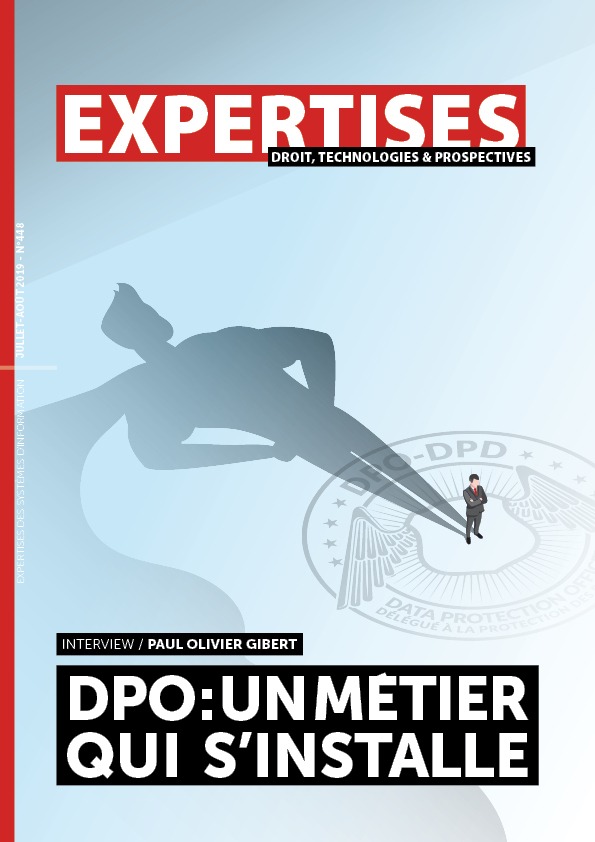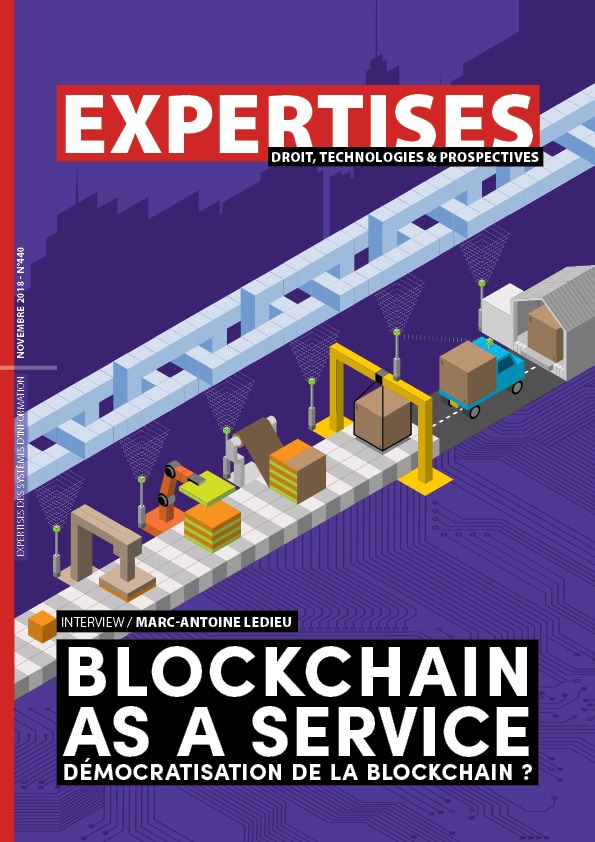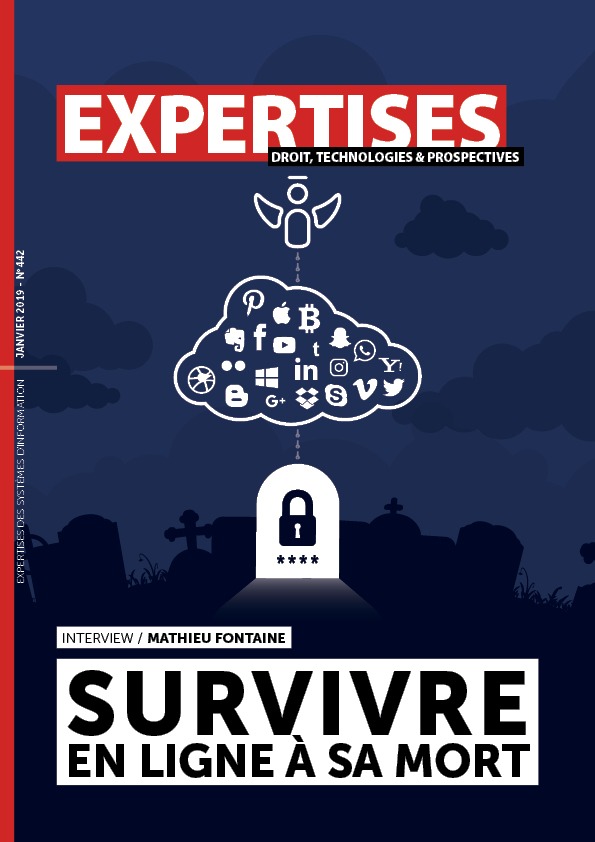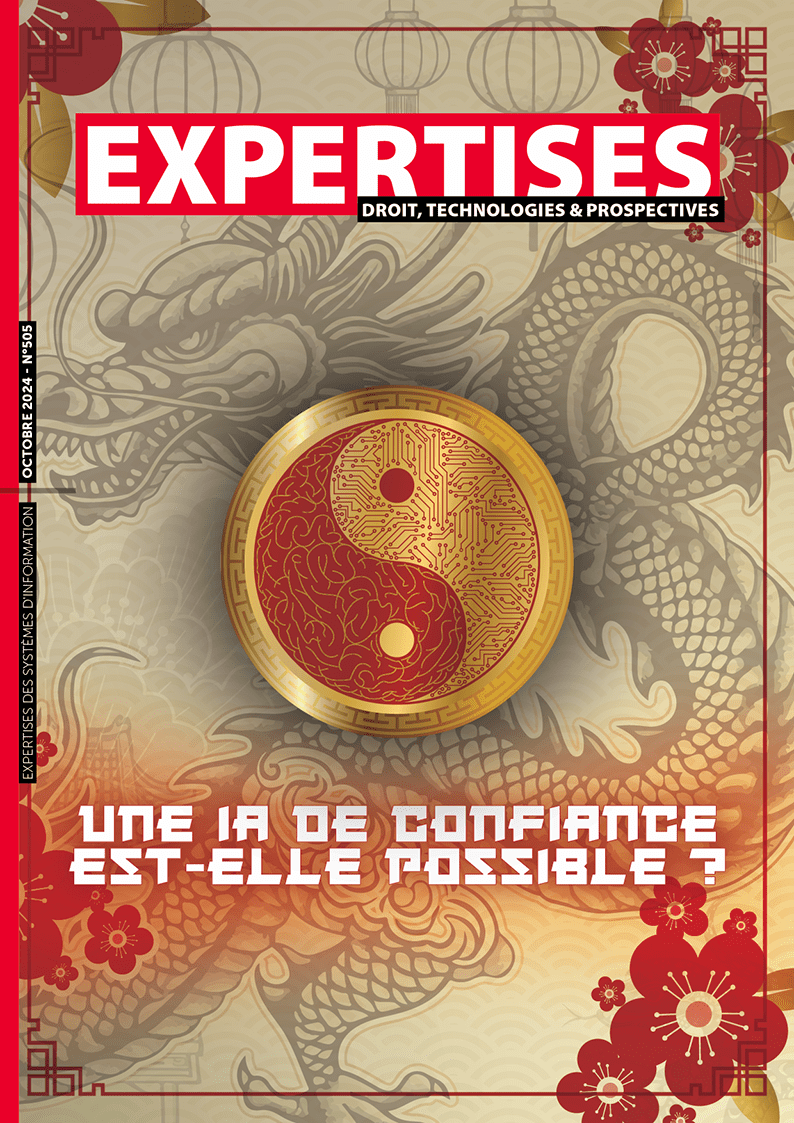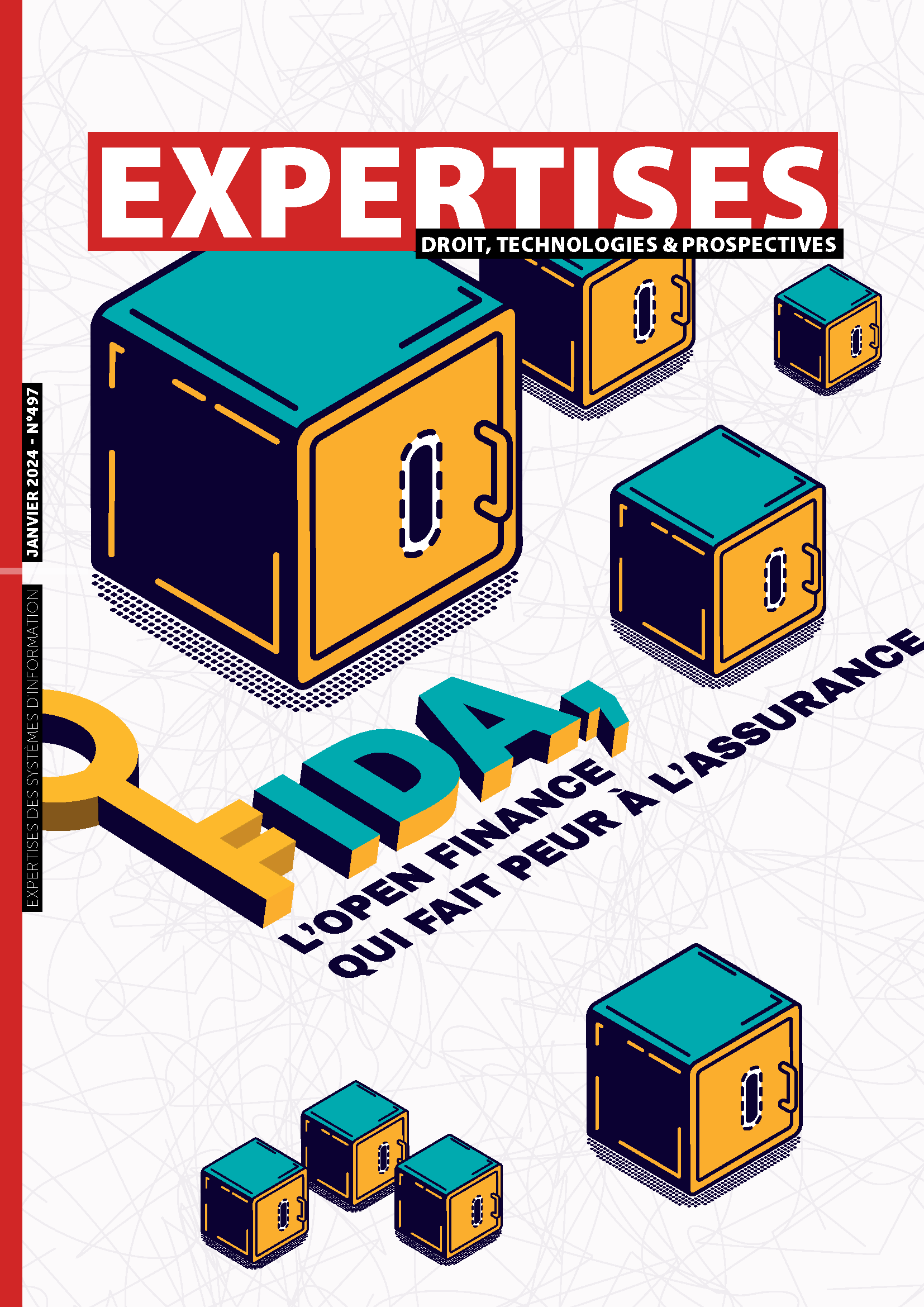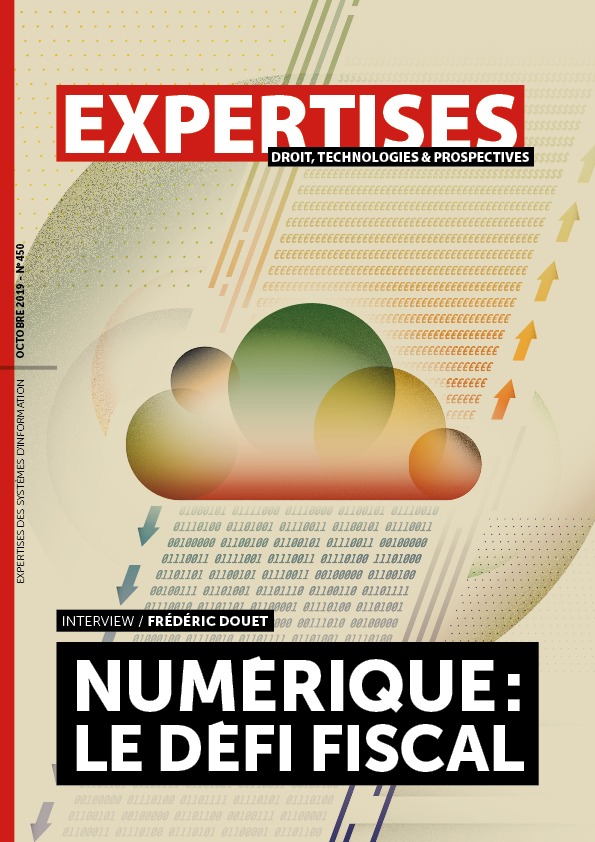Expertises
Droit, technologies & prospectives
interview / Thibault du Manoir de Juaye
Manipulation sur les réseaux sociaux - Les limites du droit

Droit, technologies & prospectives
Tous les mois, toute l'actualité du numérique... Et tellement plus !
Nos derniers numéros

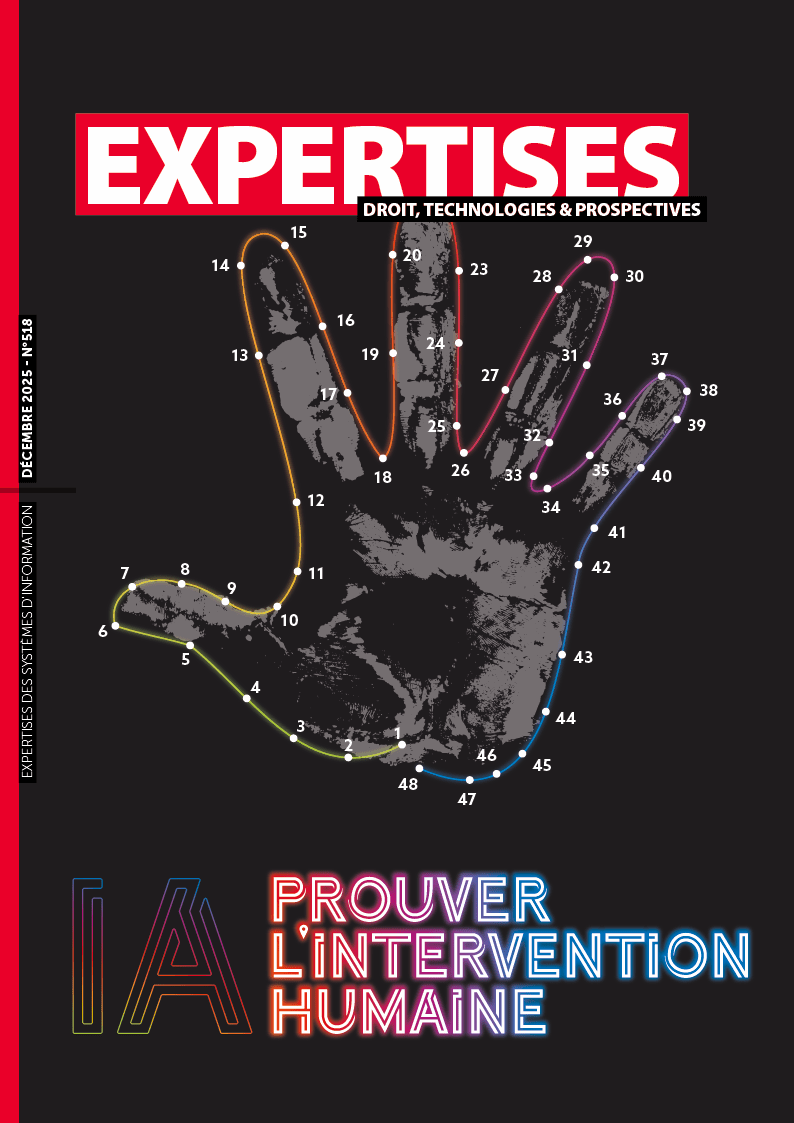


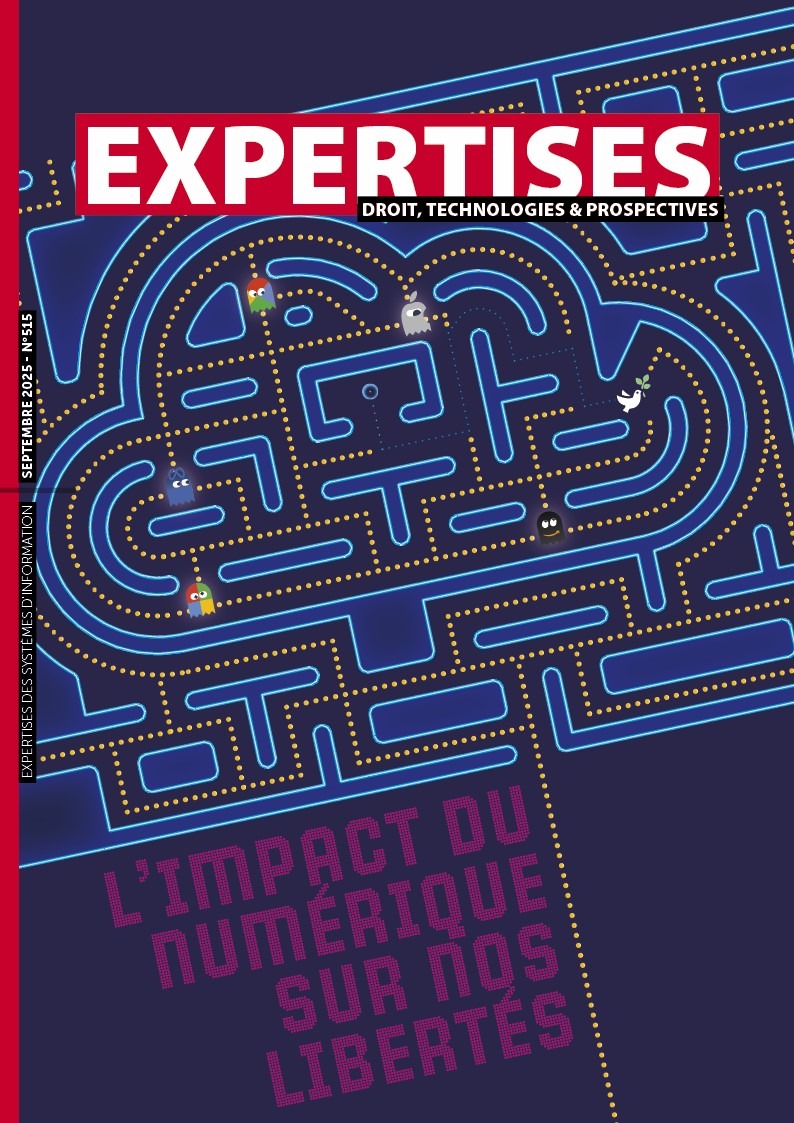
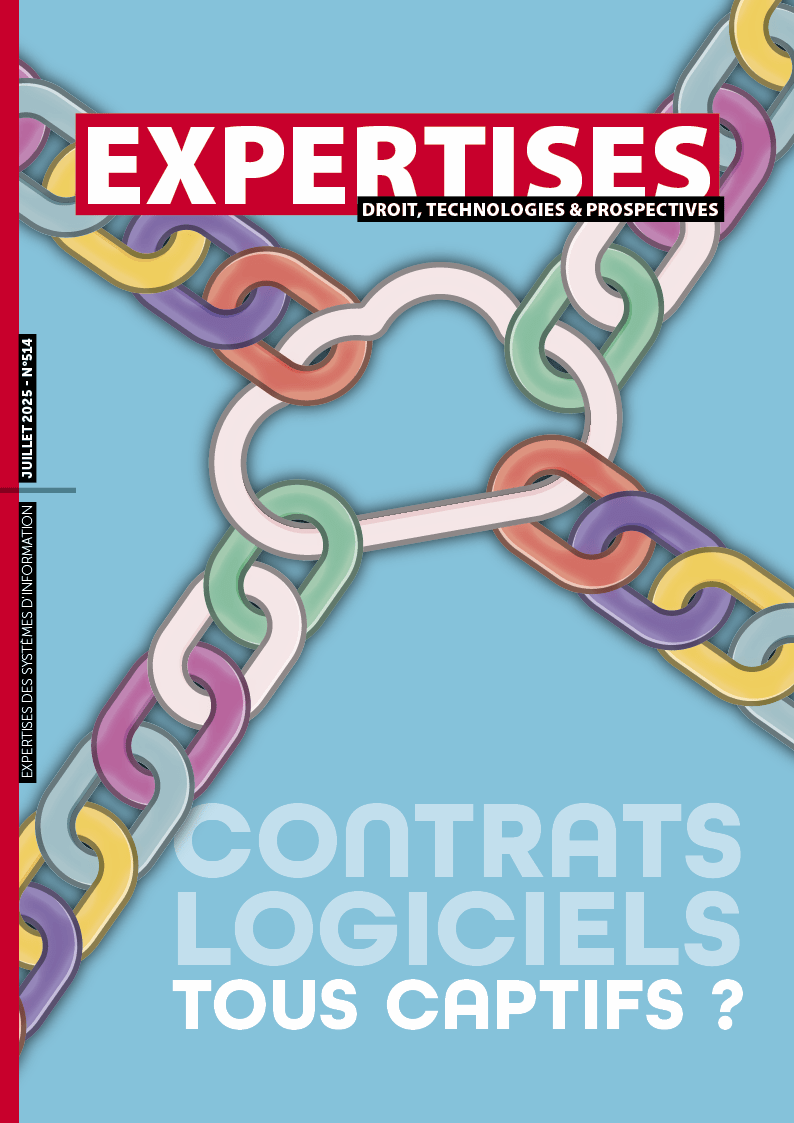

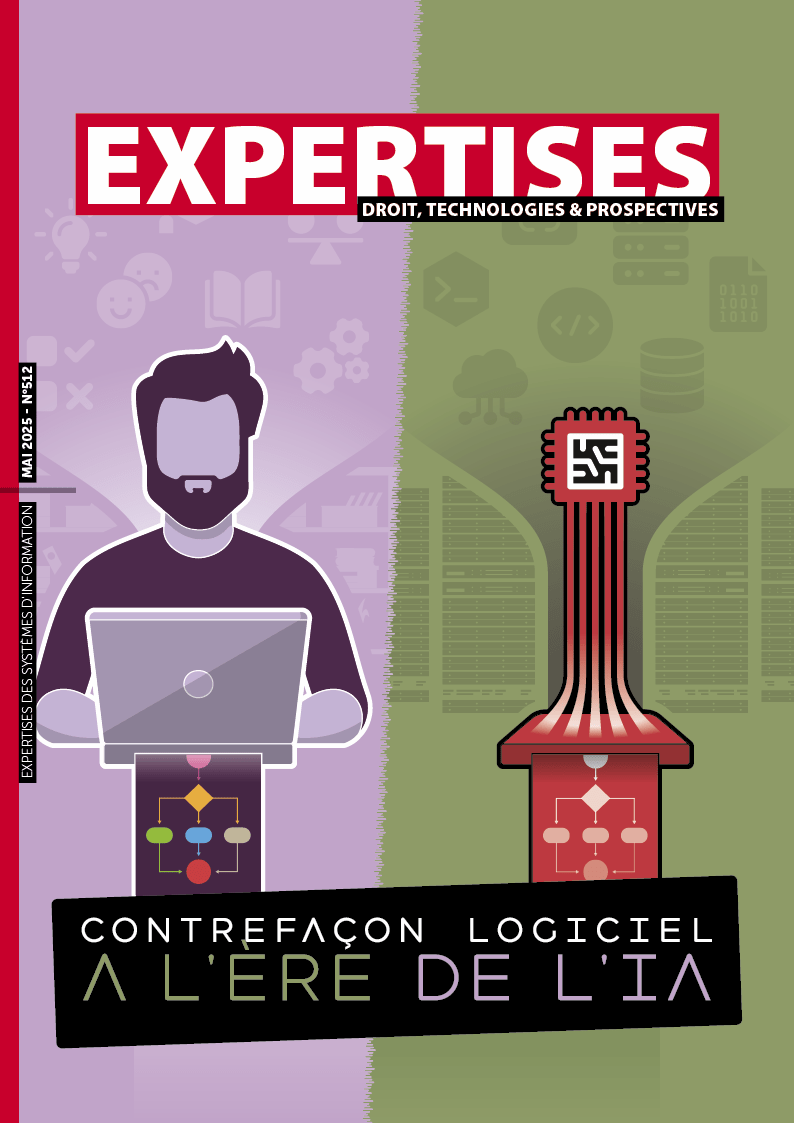



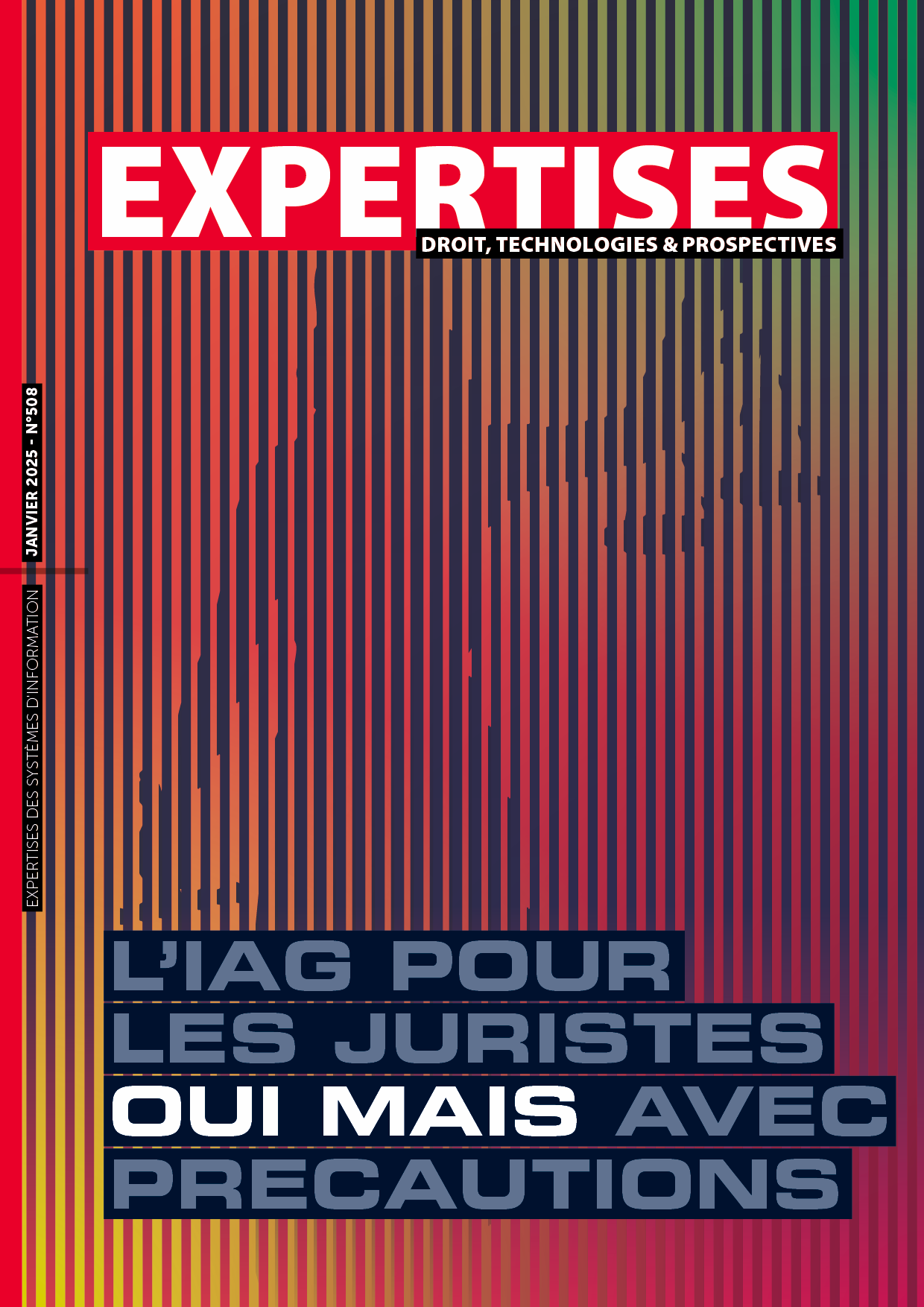


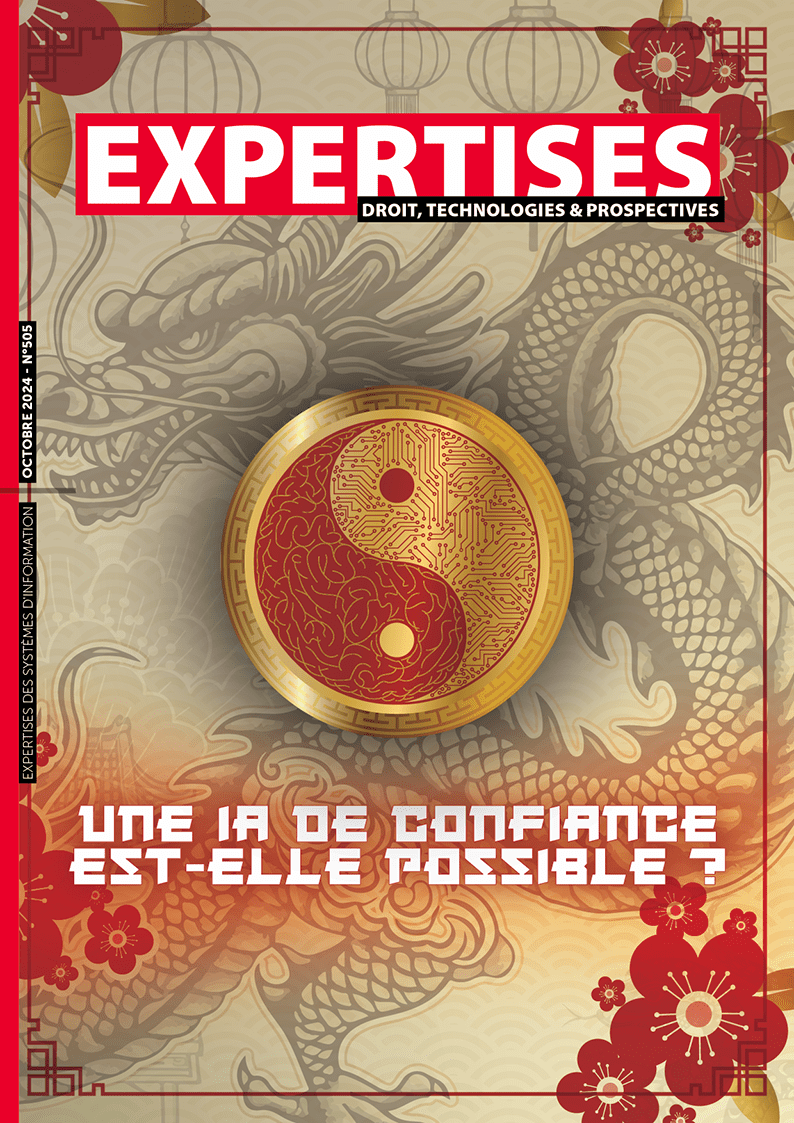
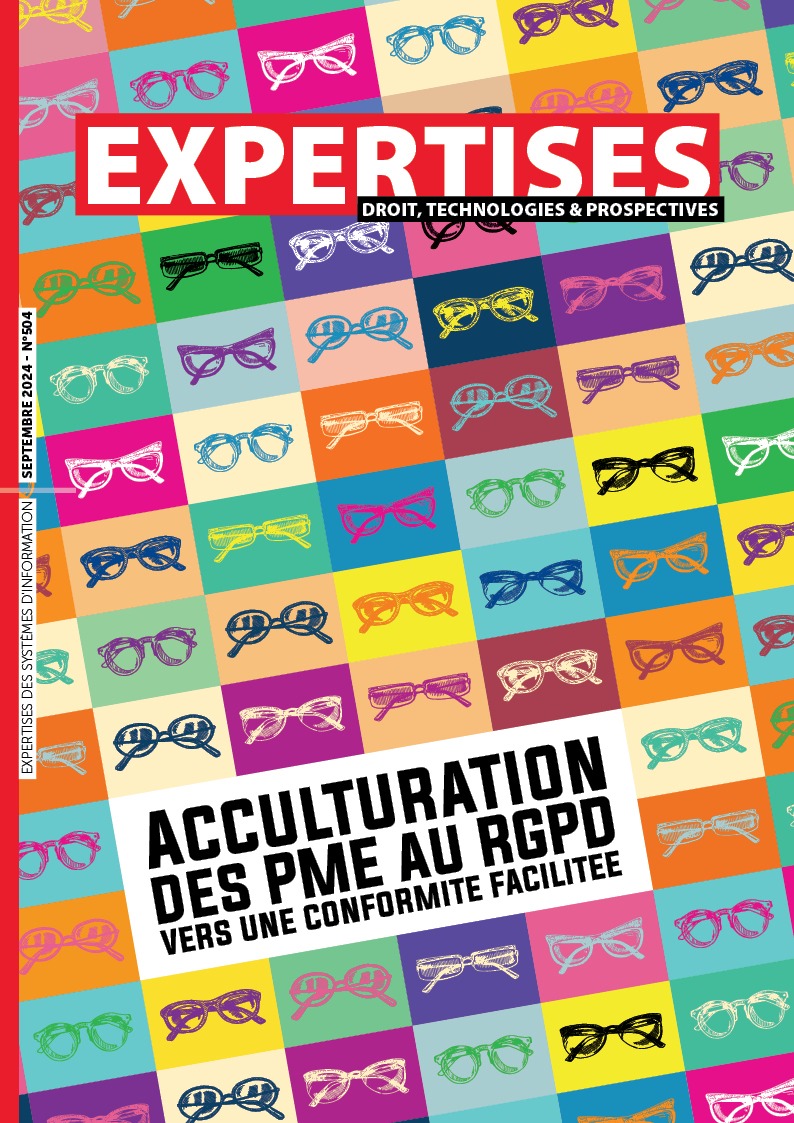
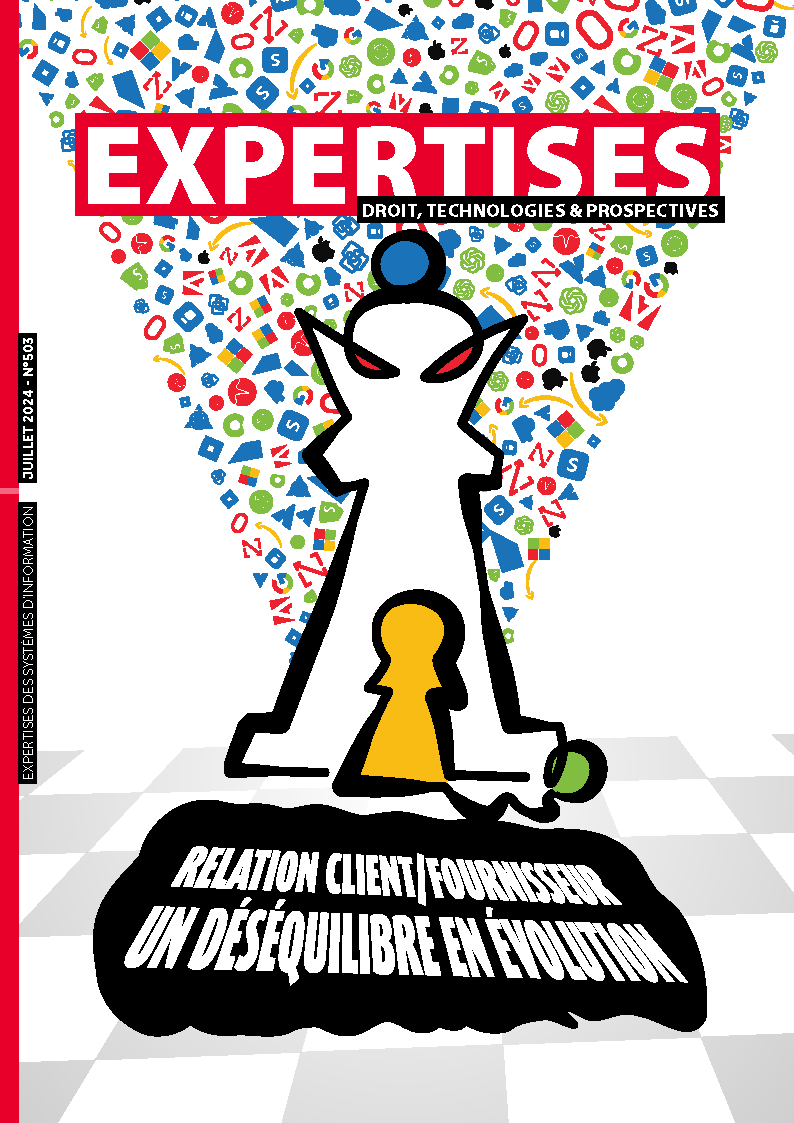

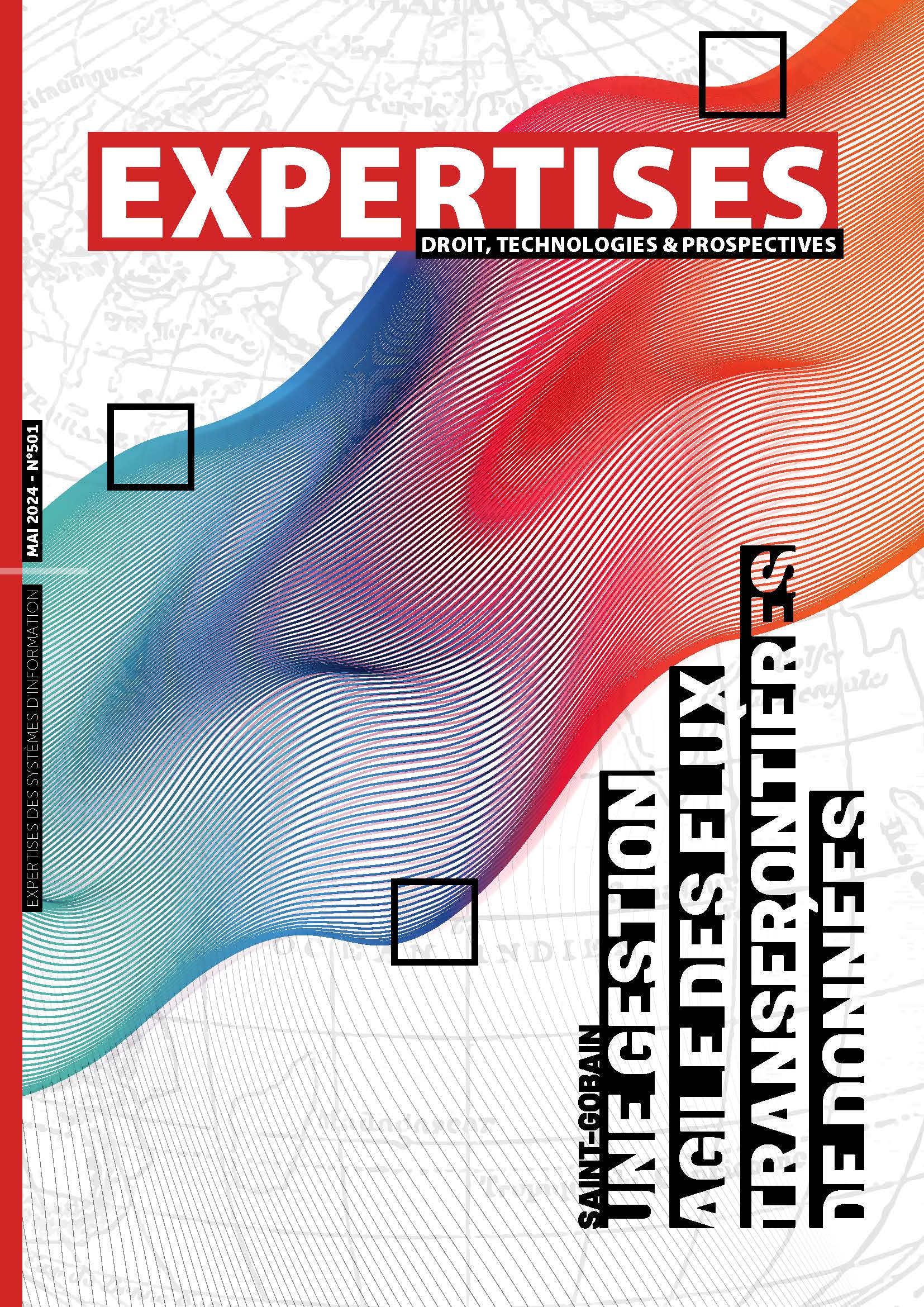
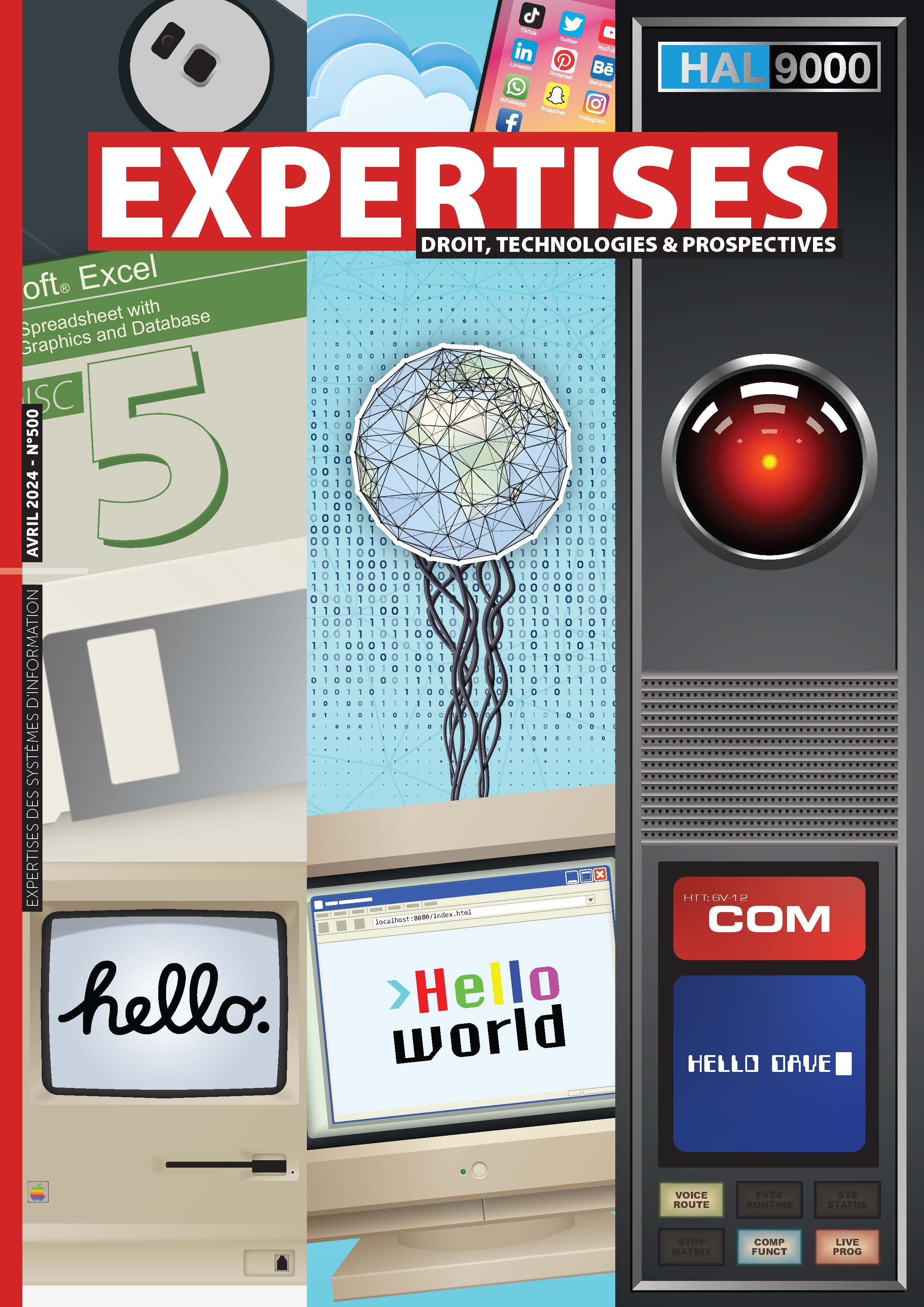

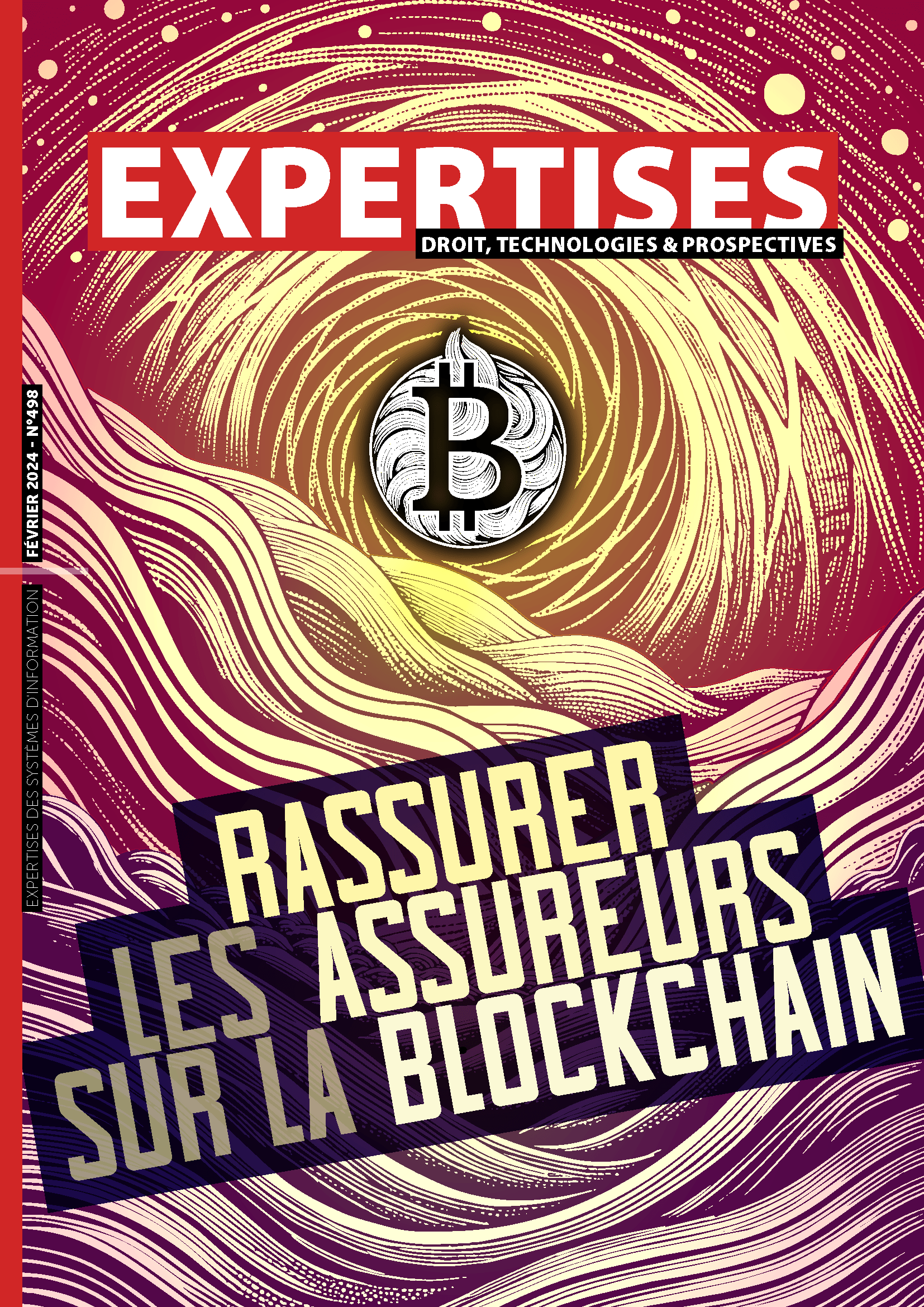
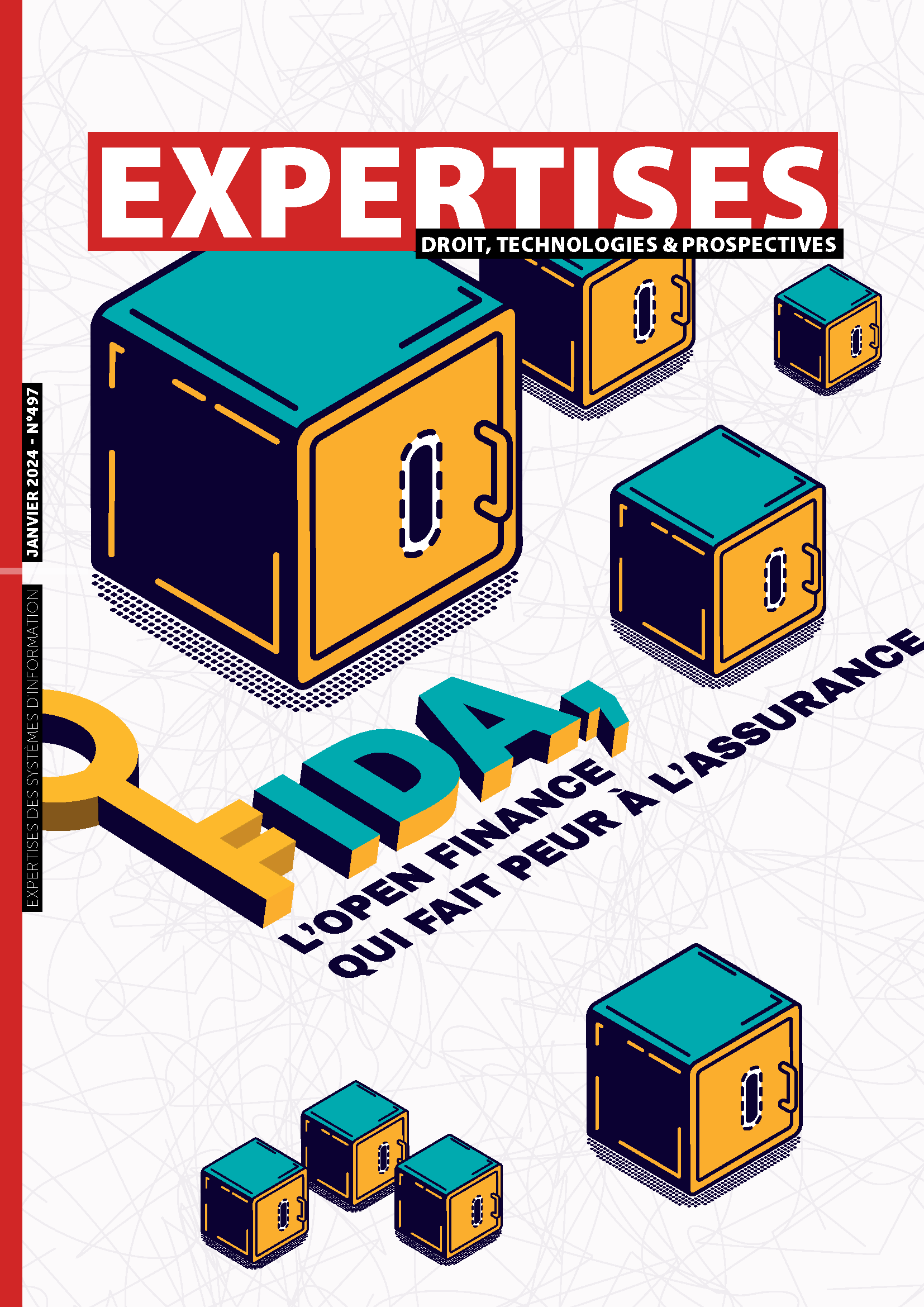
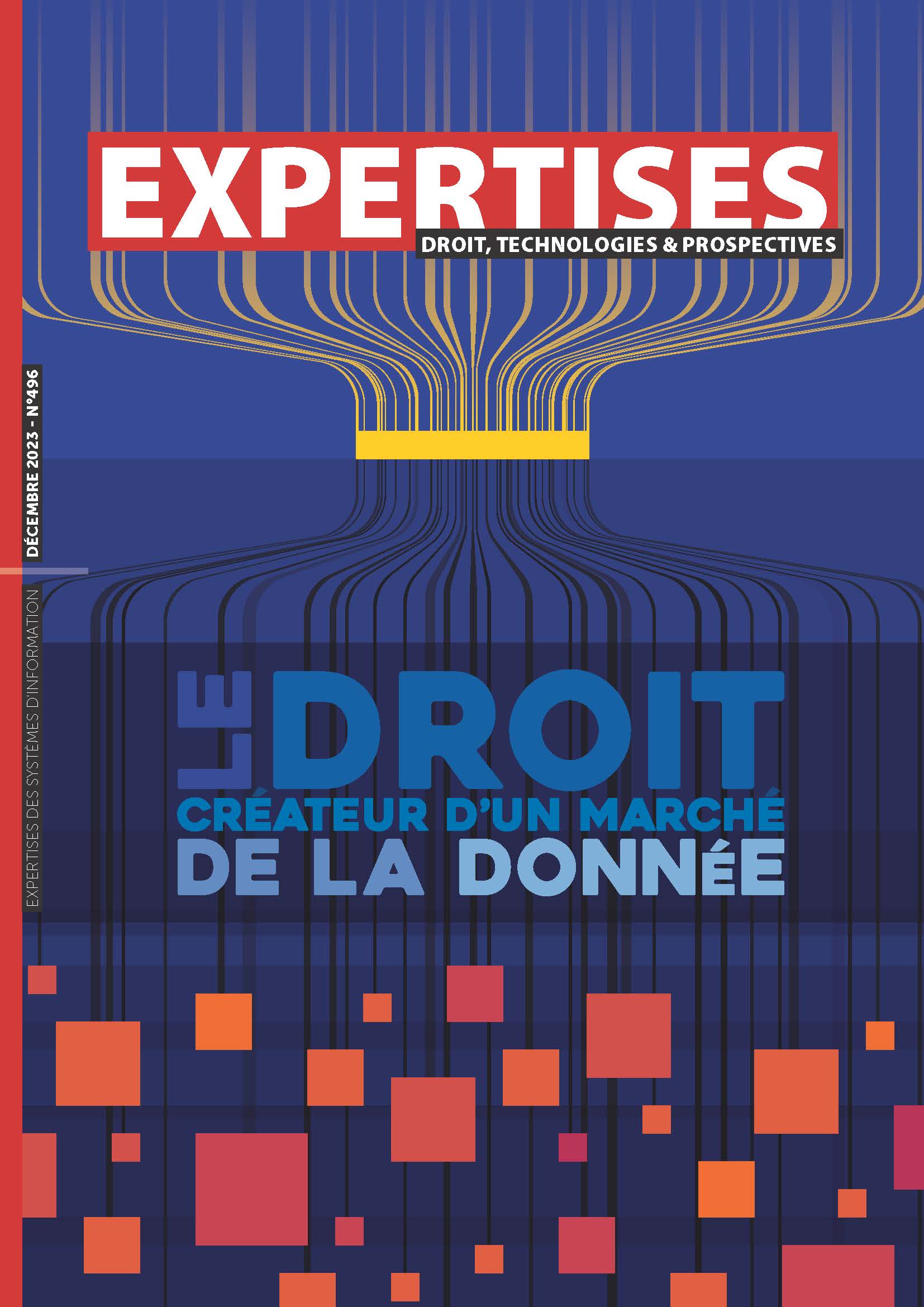
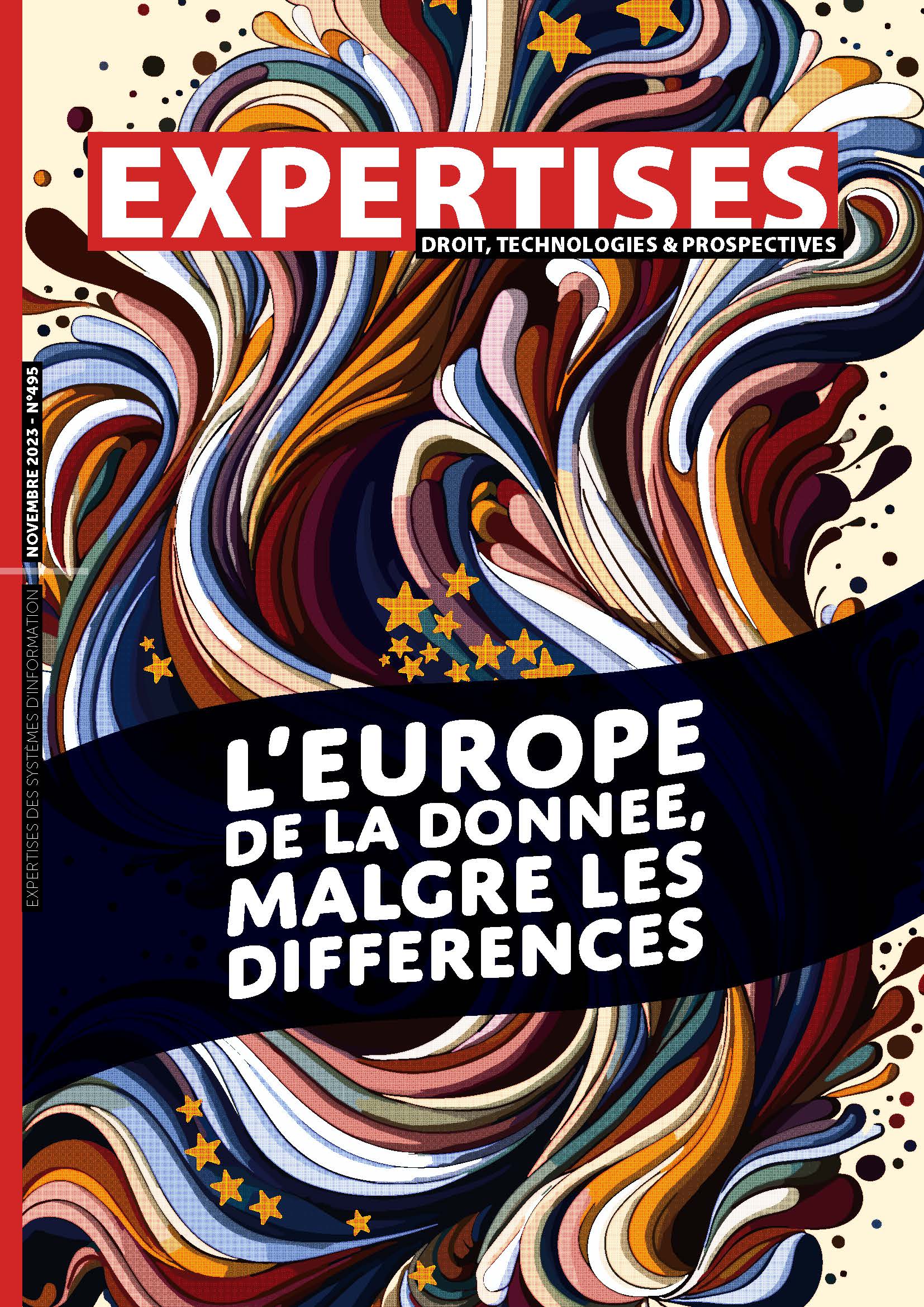

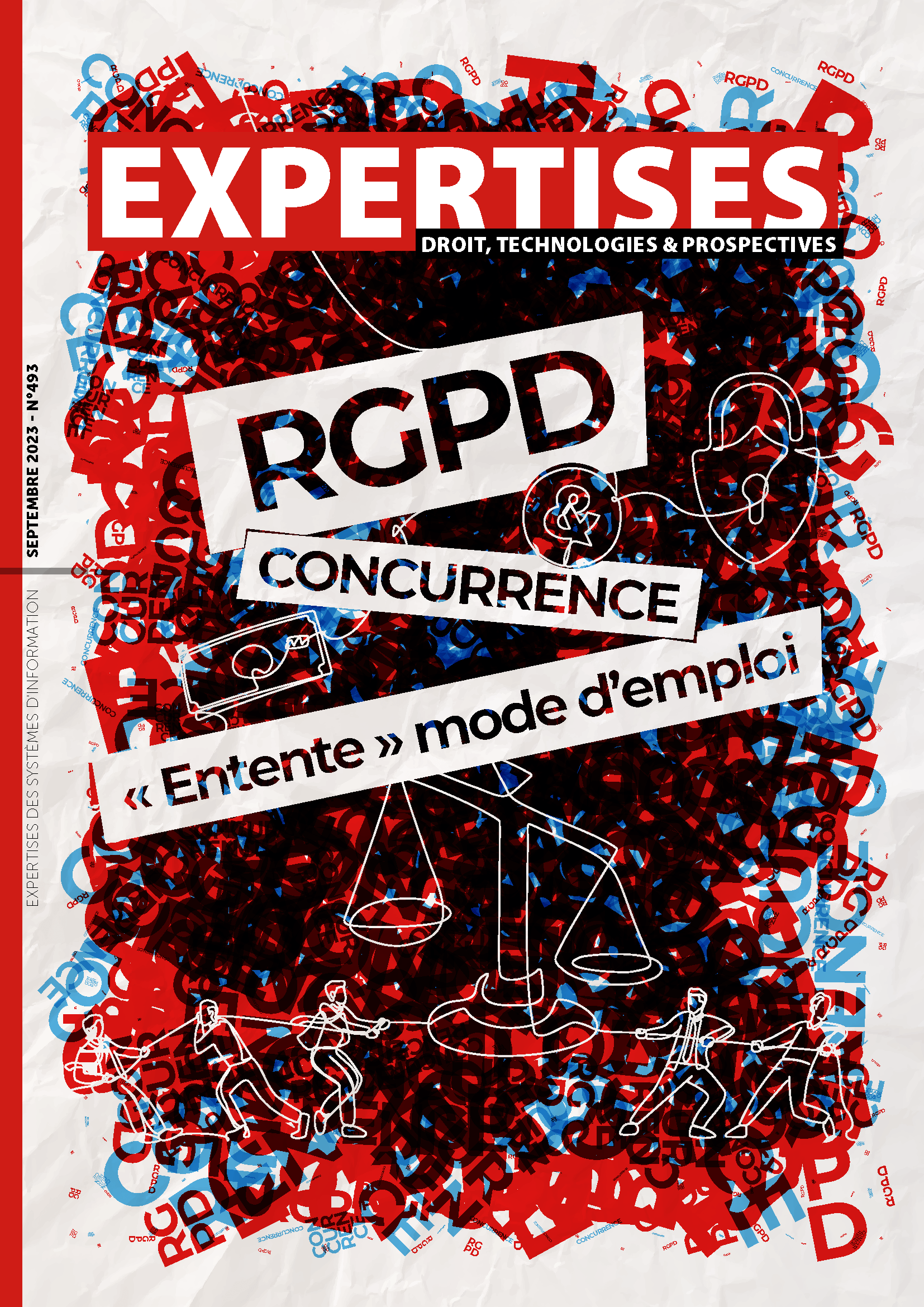
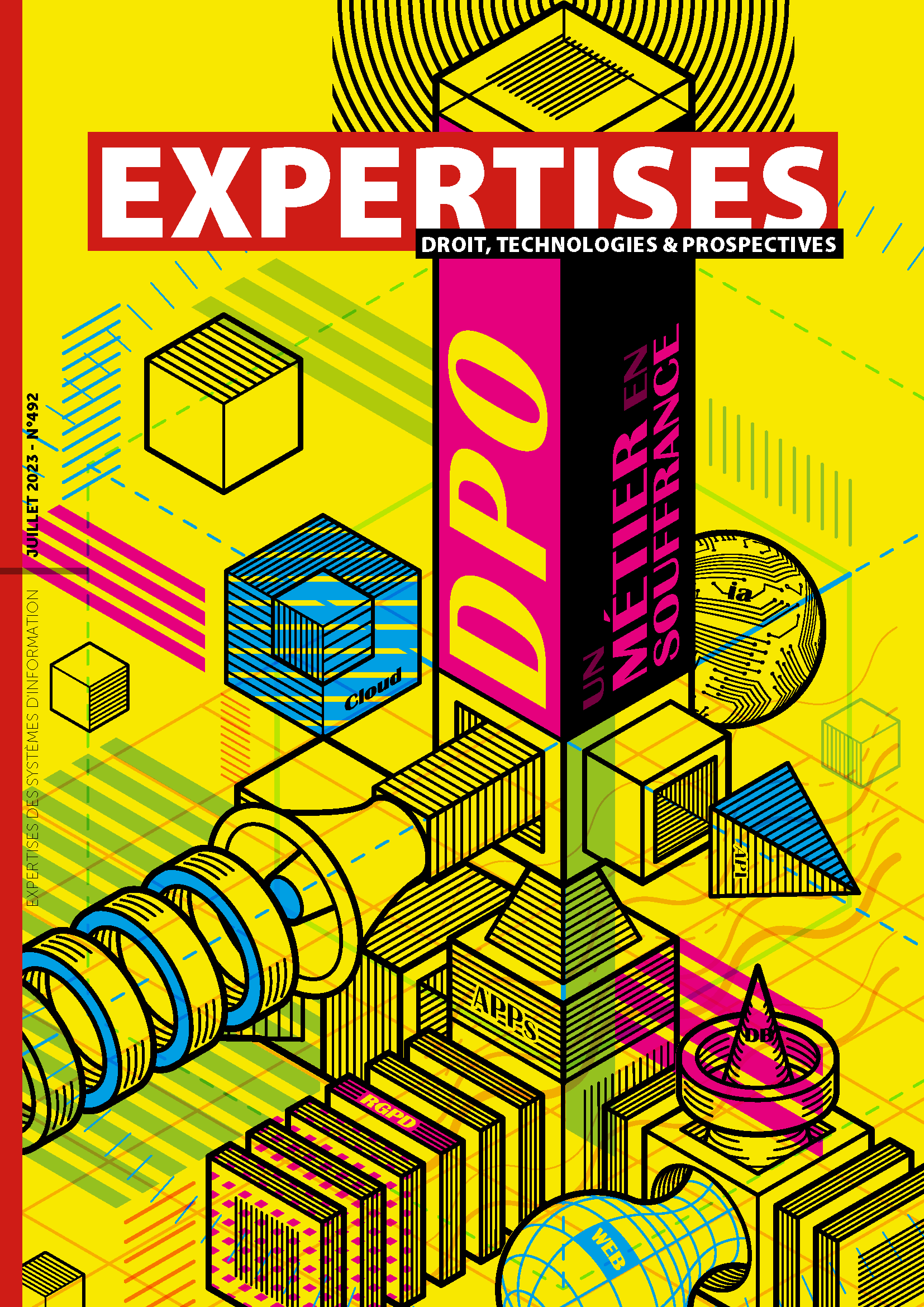
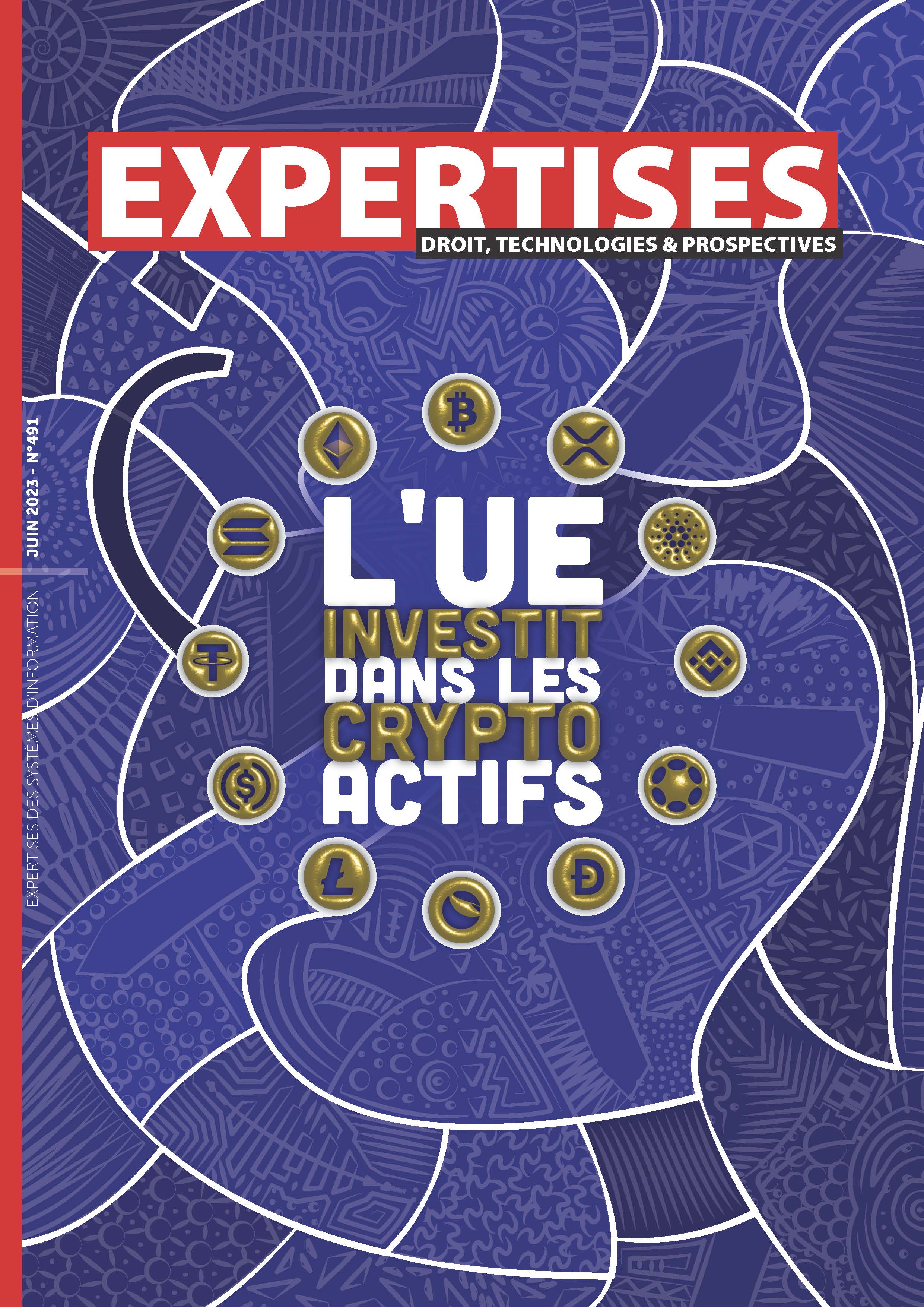
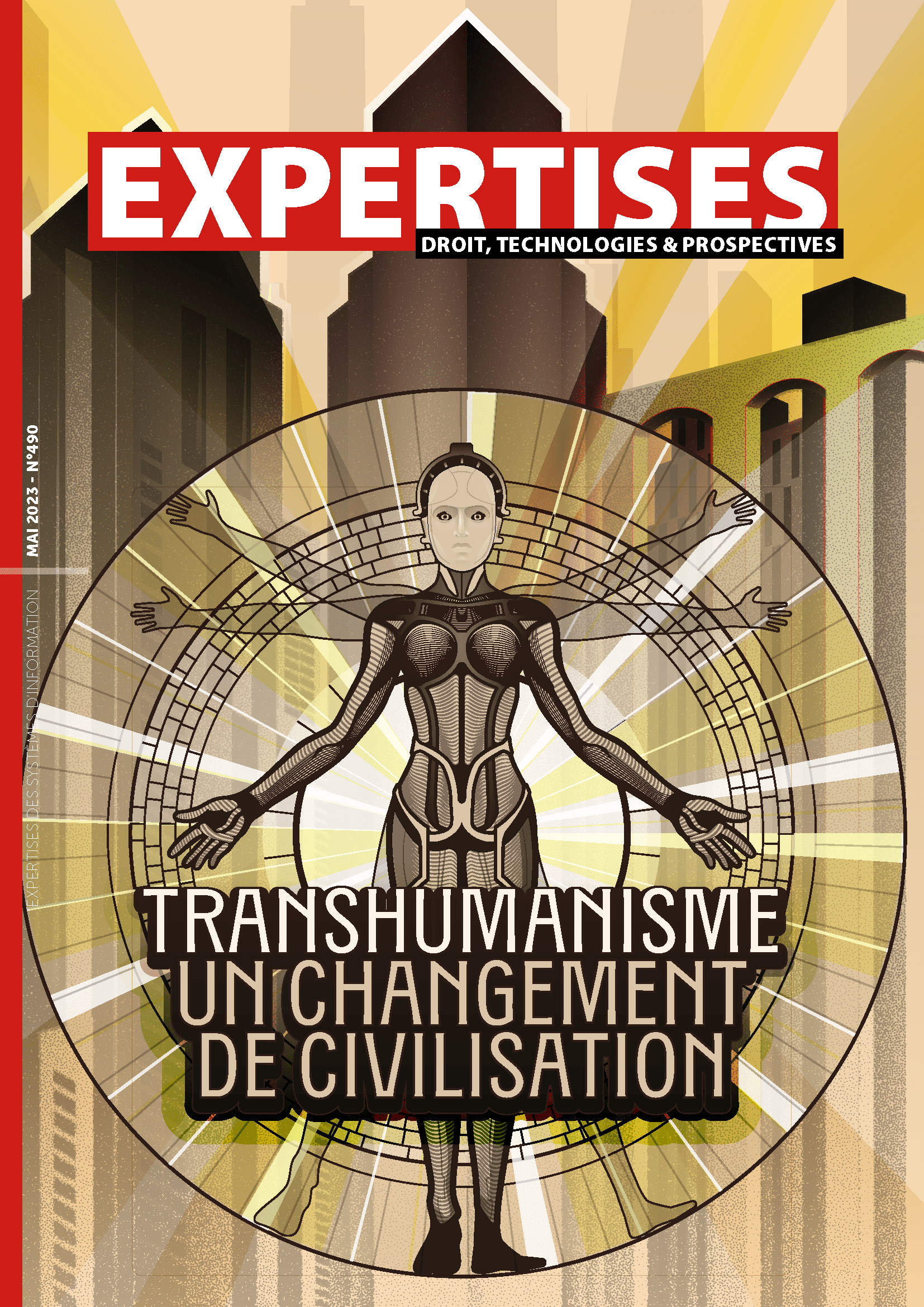
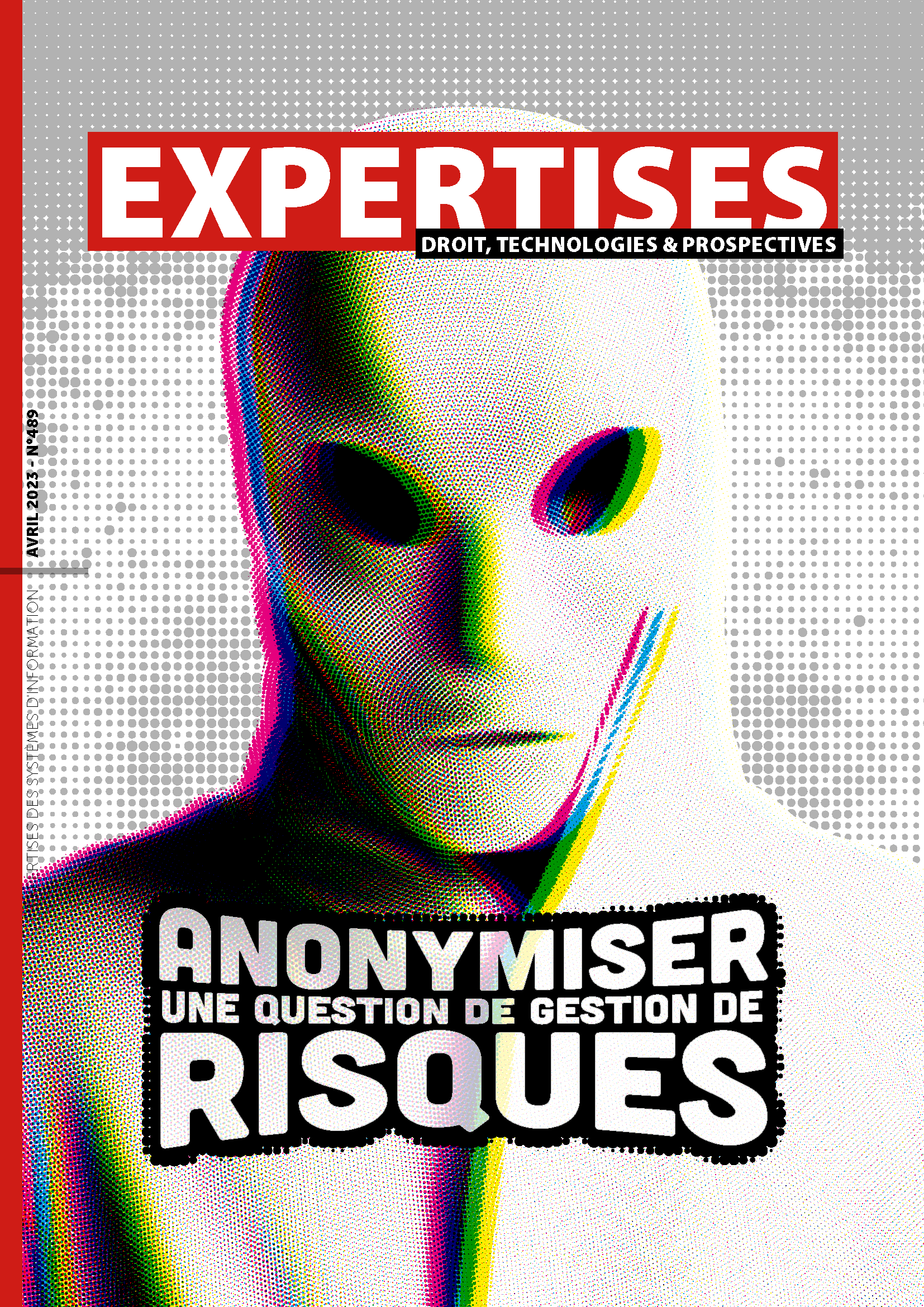

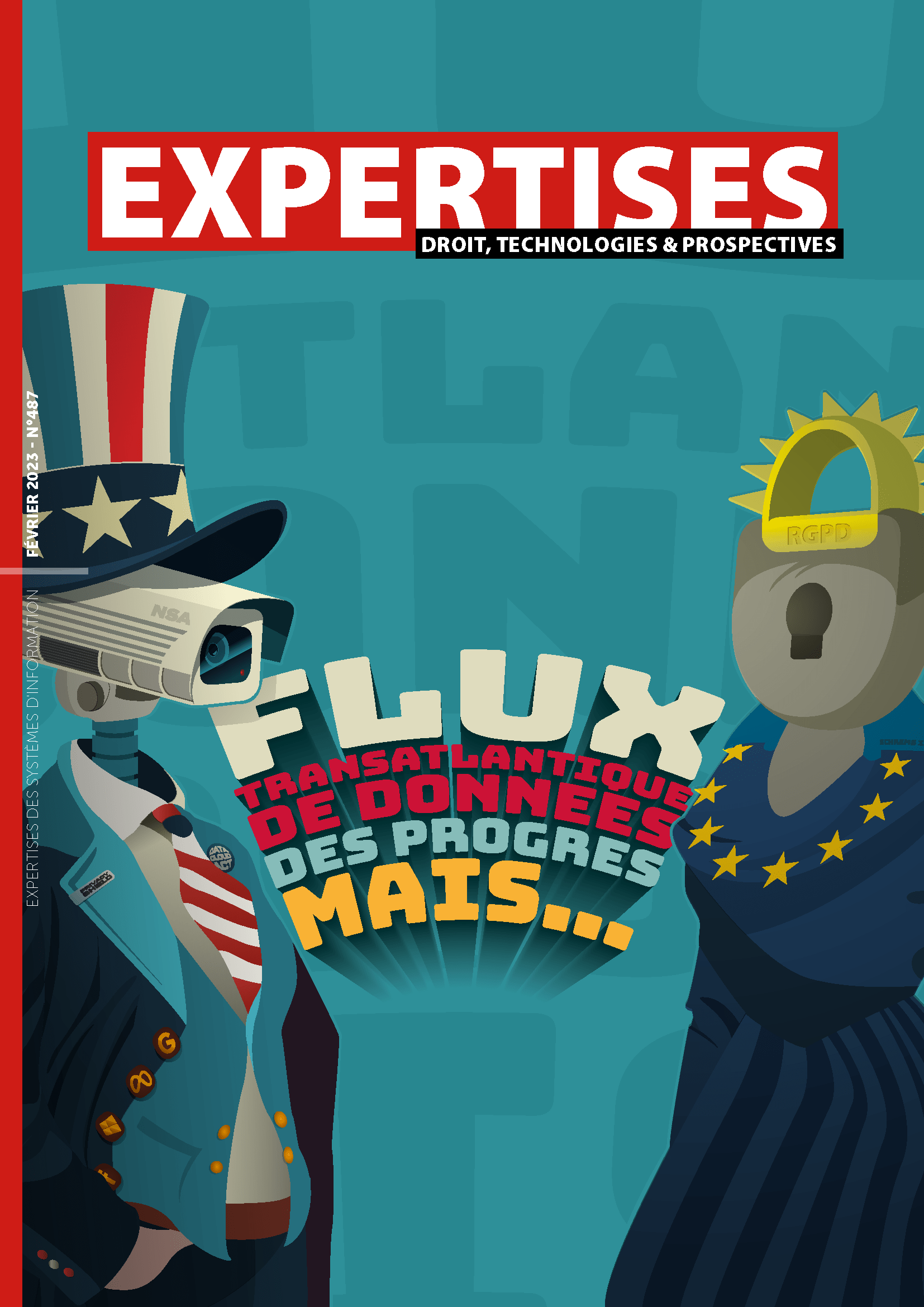

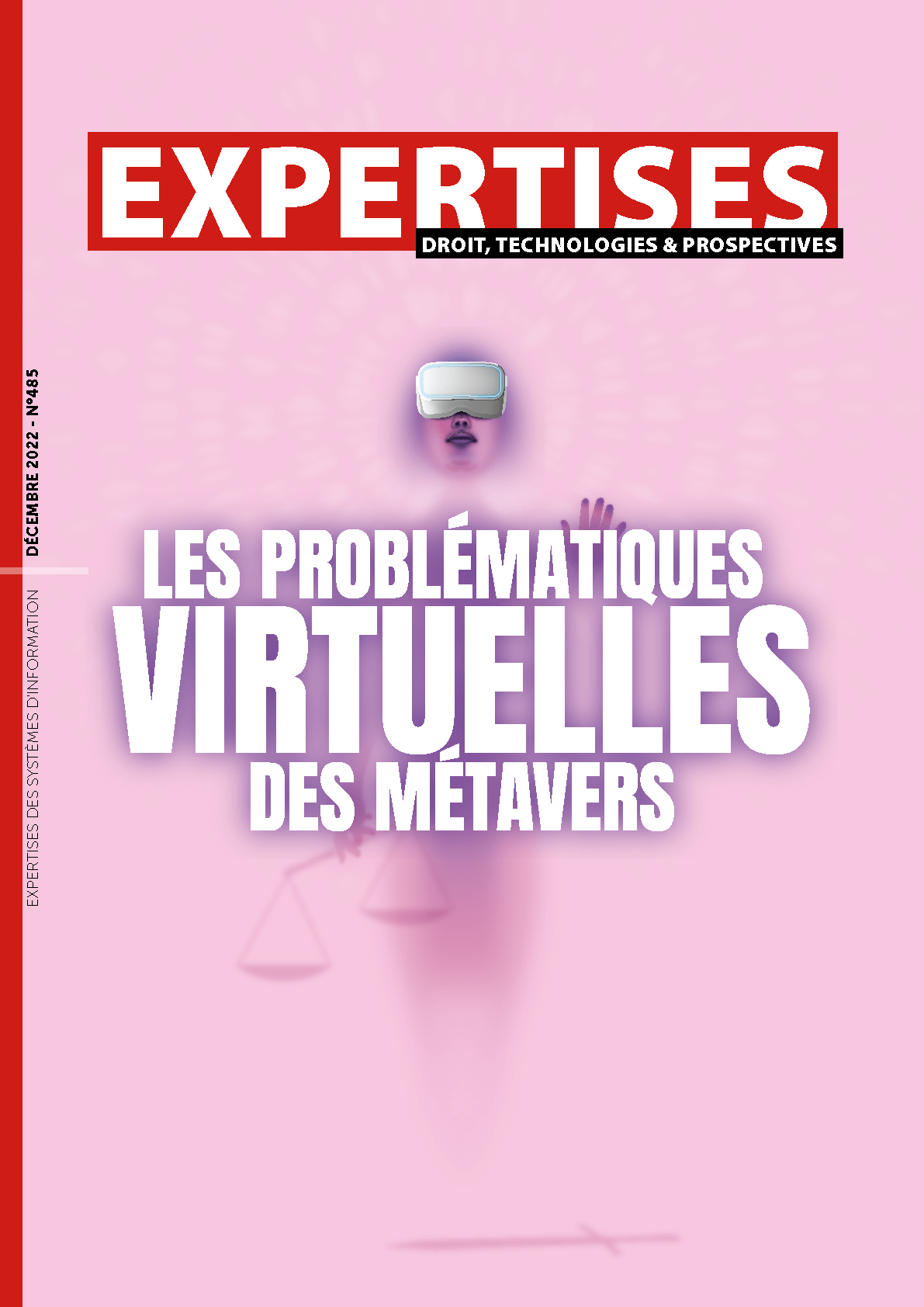
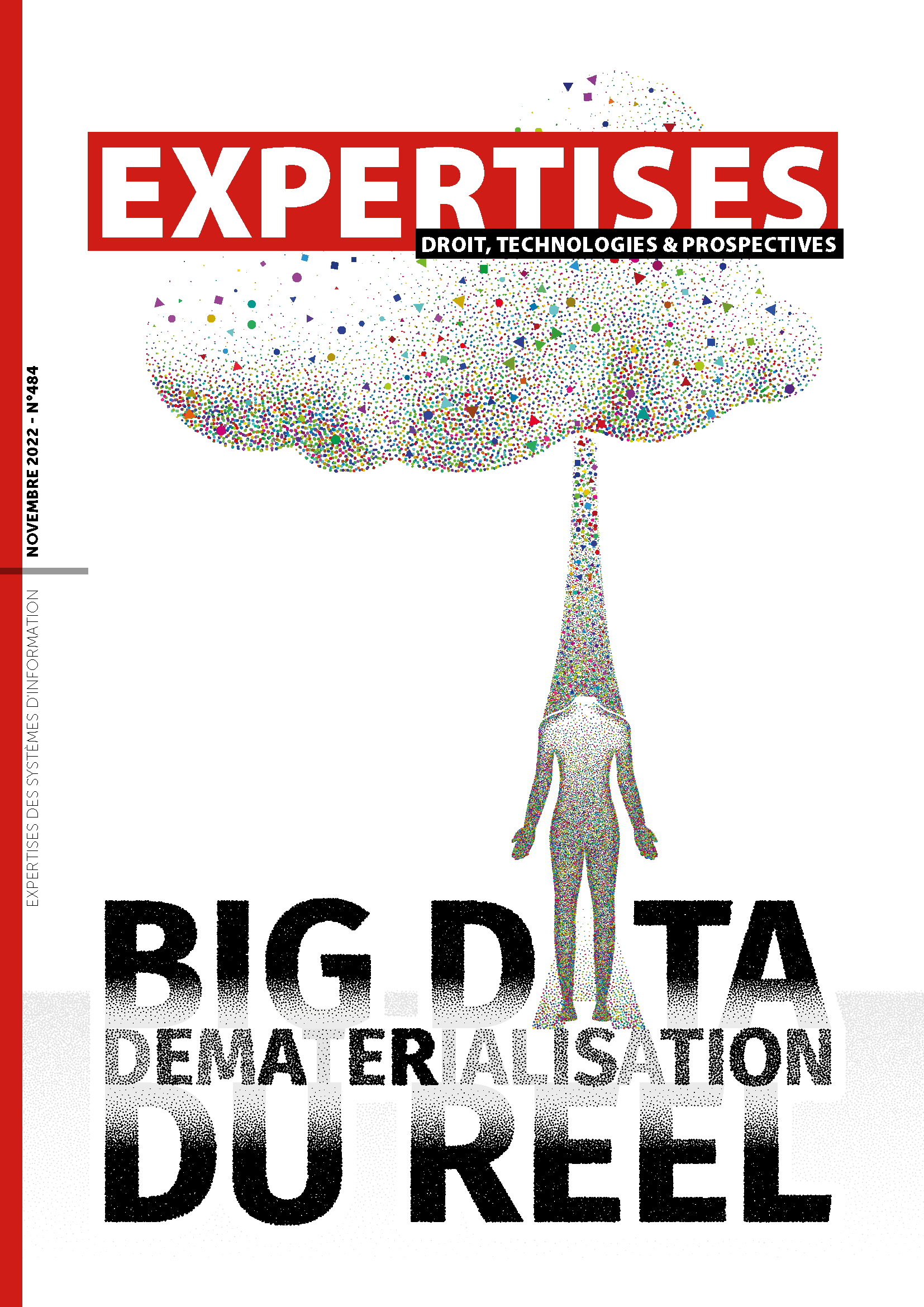


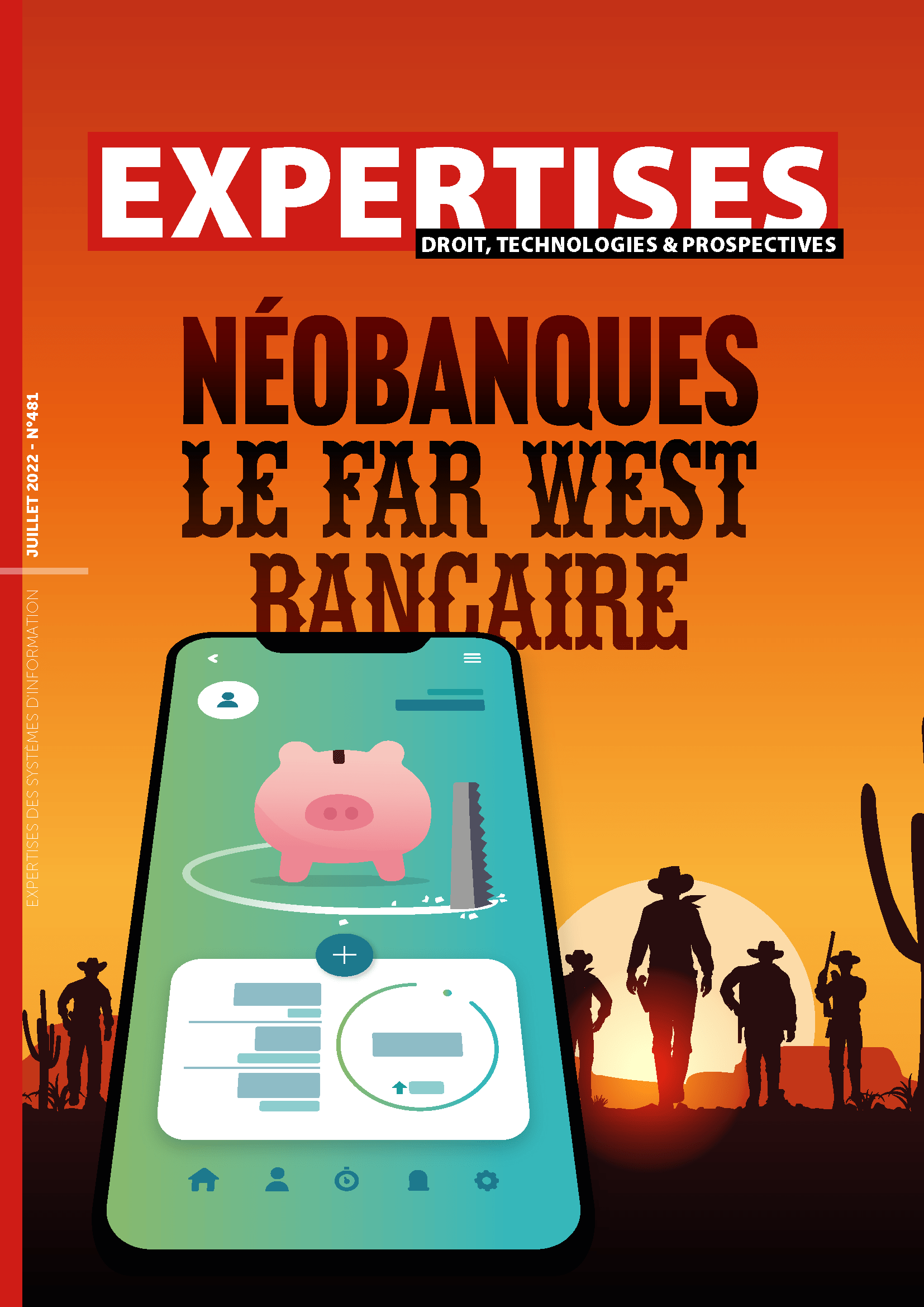

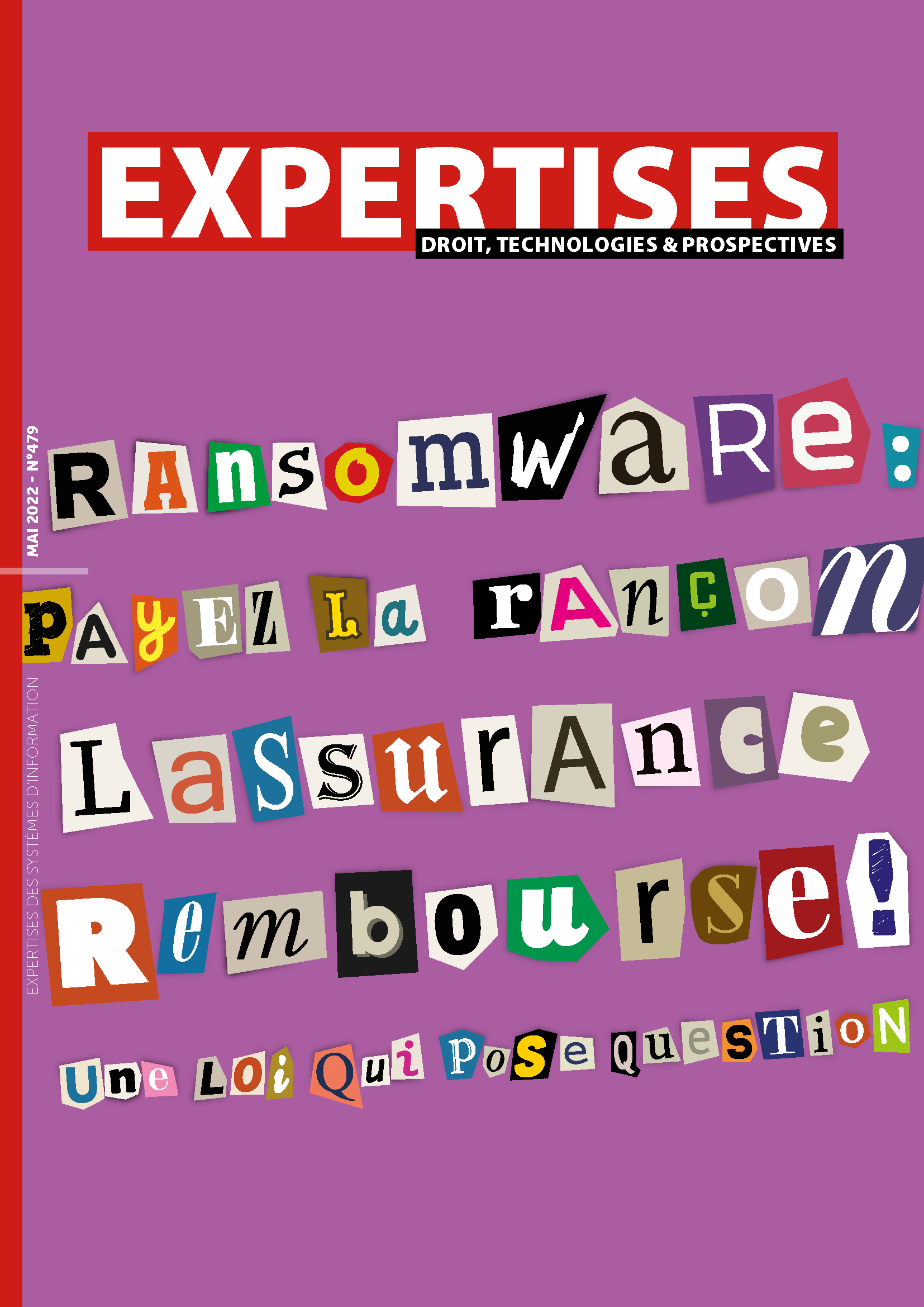

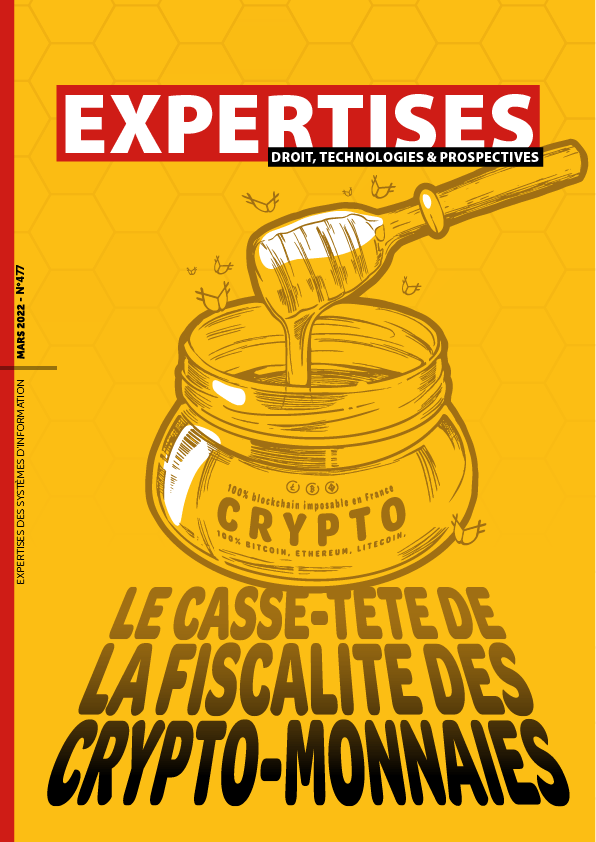
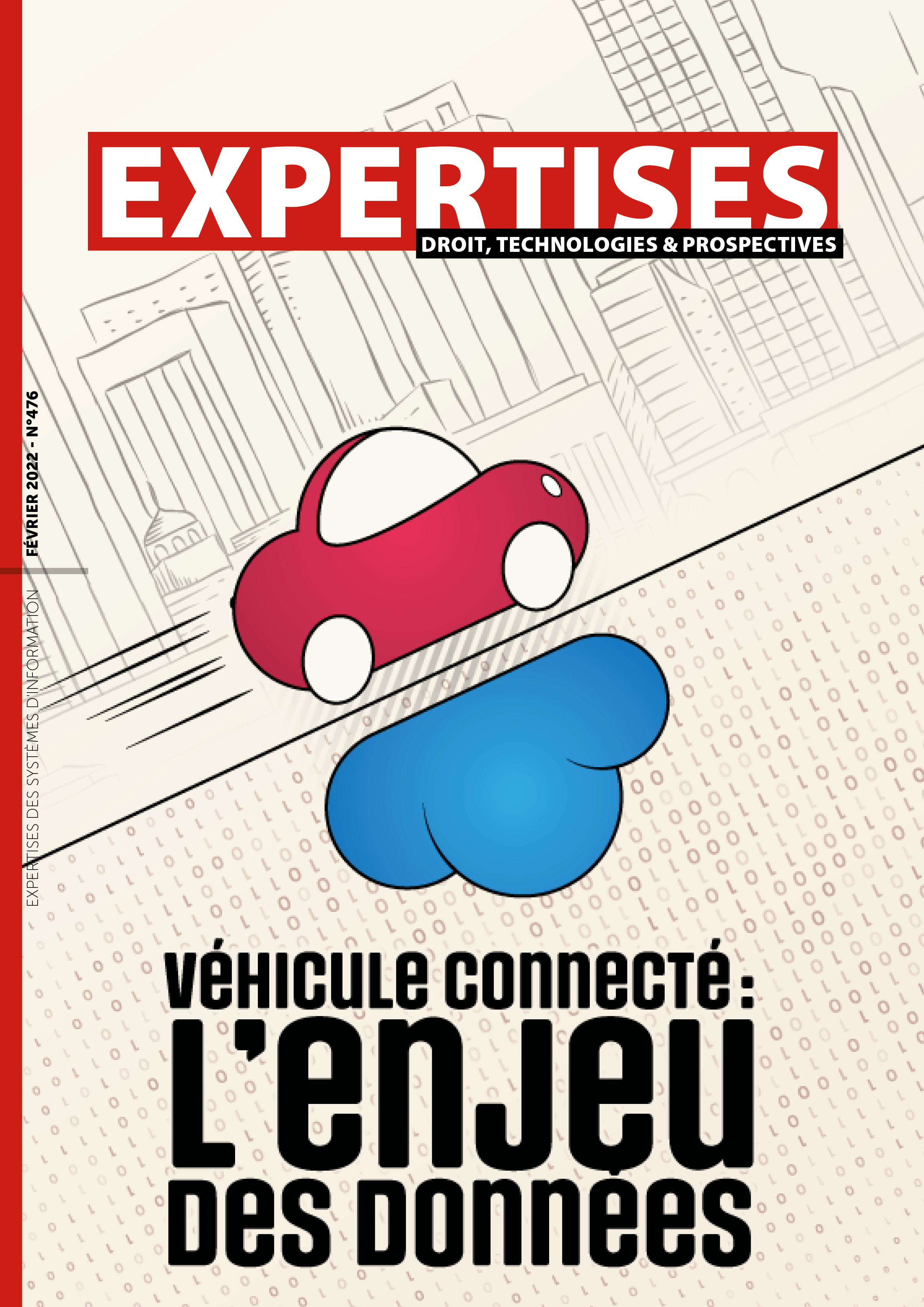

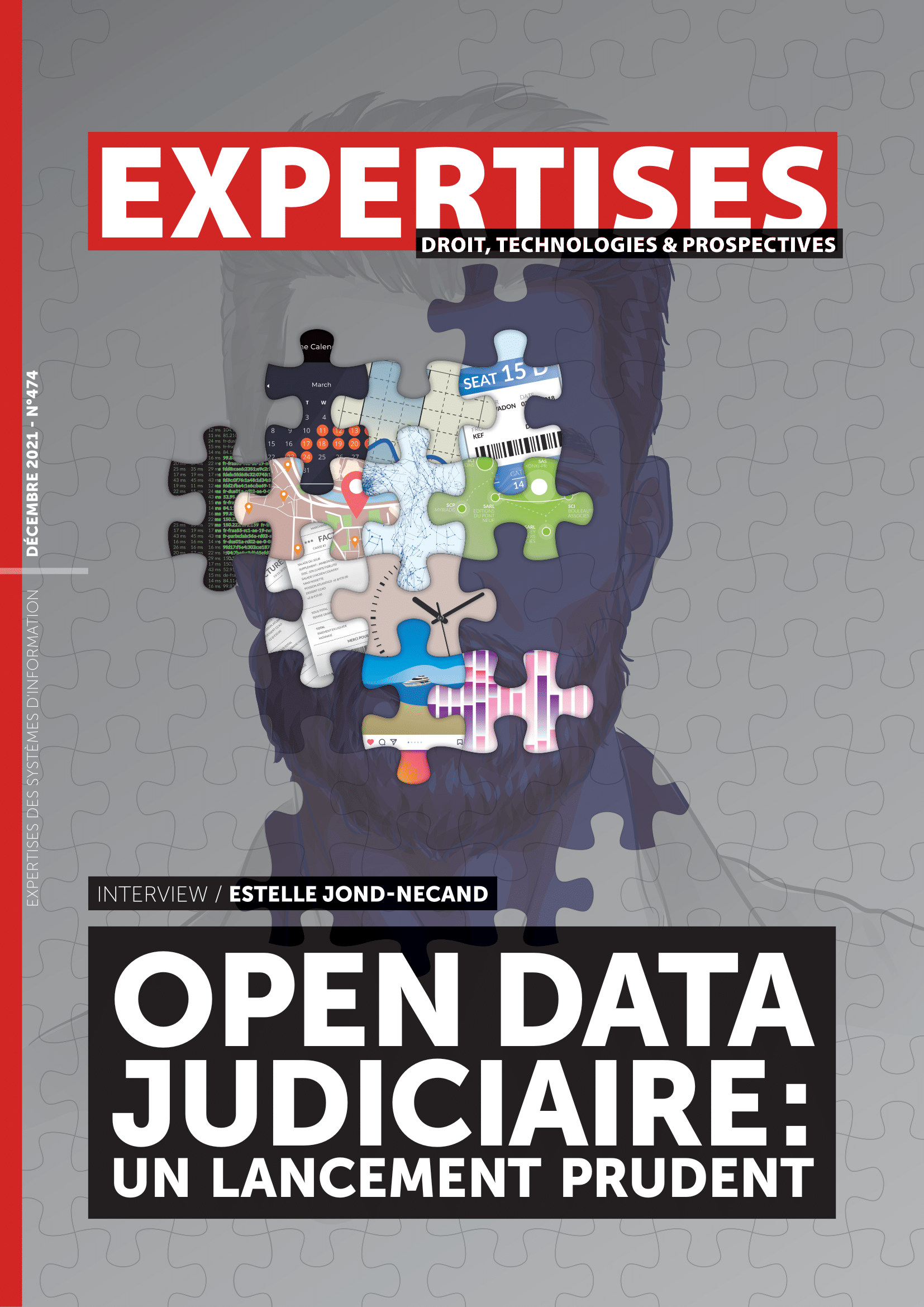

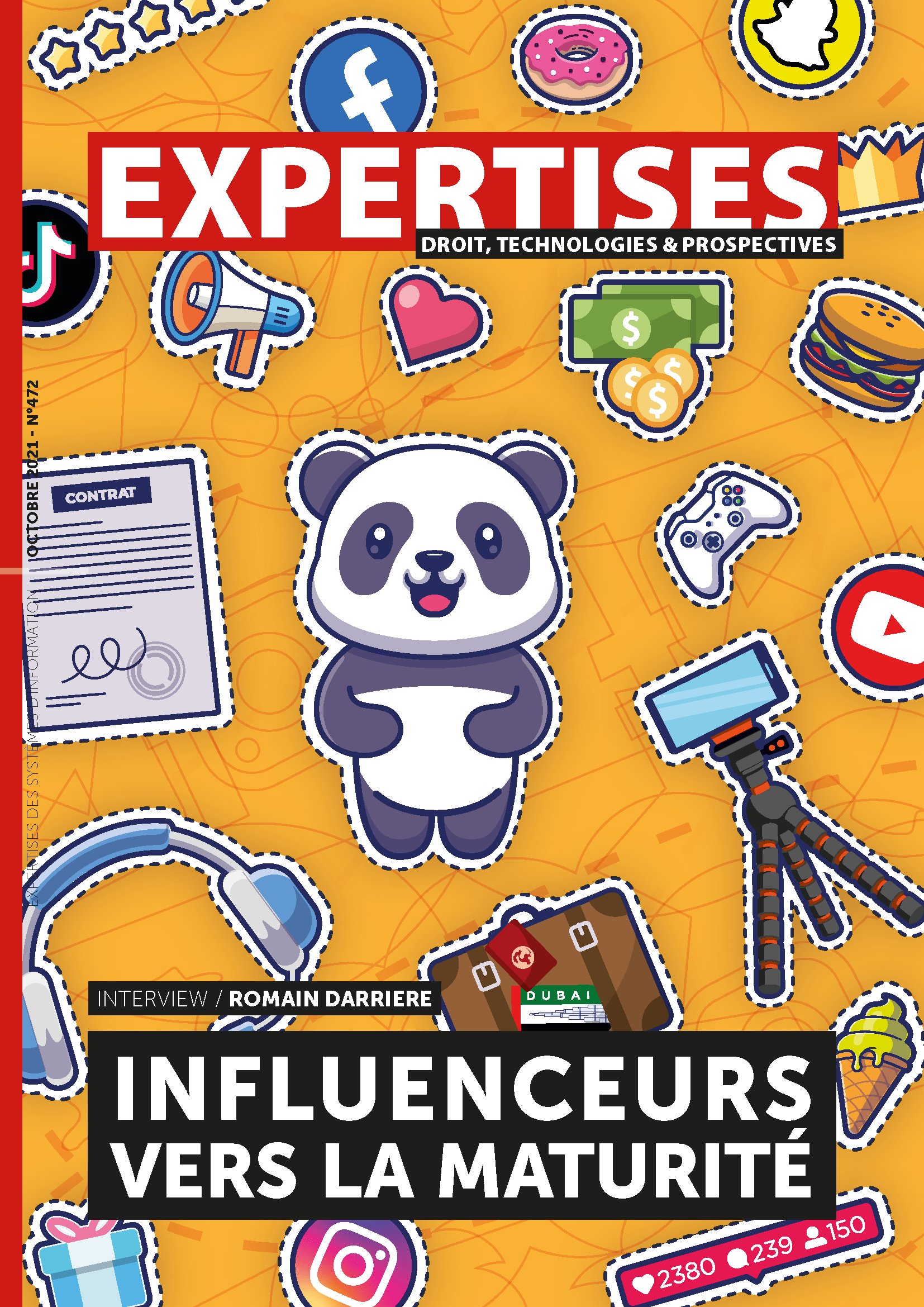


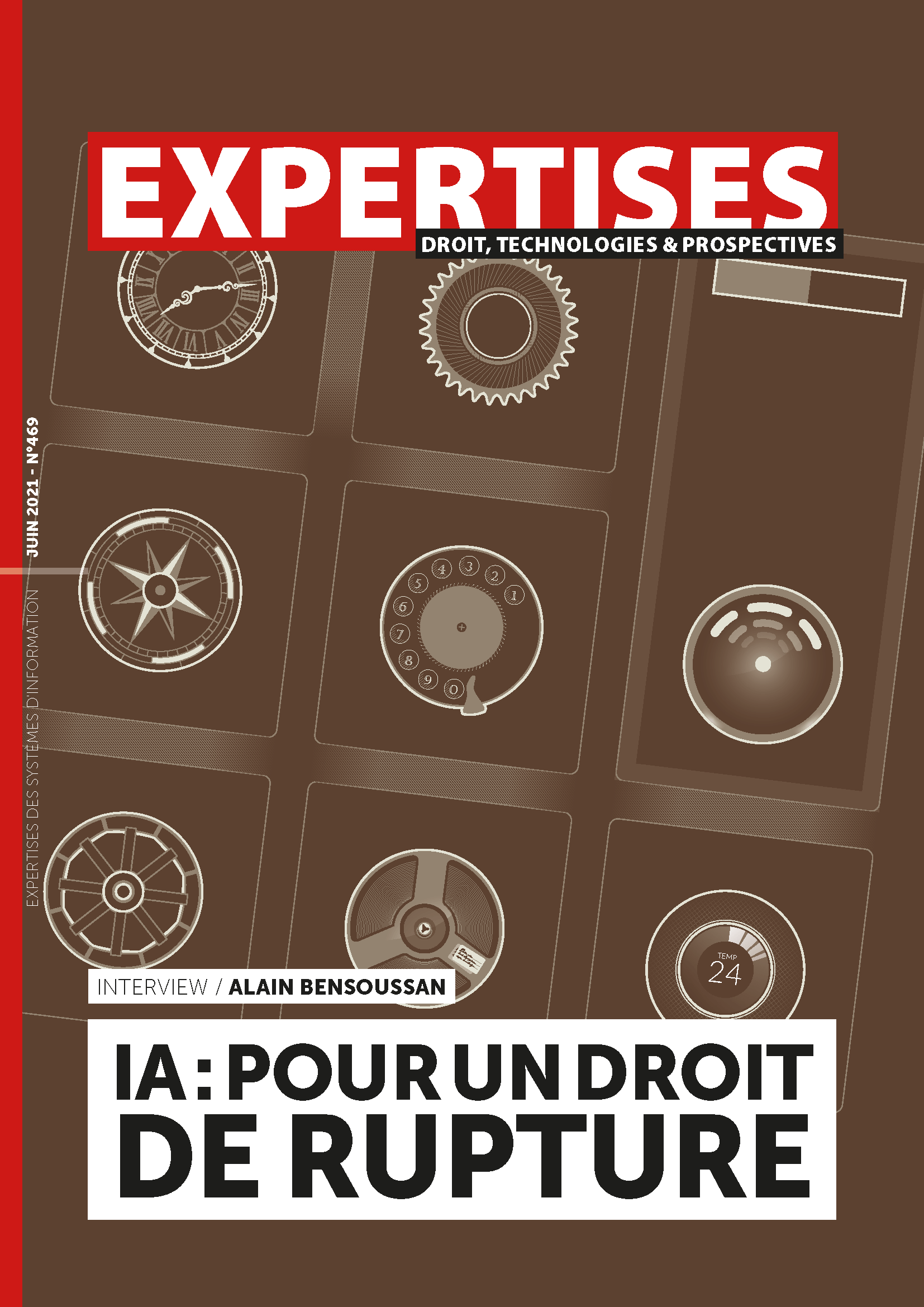
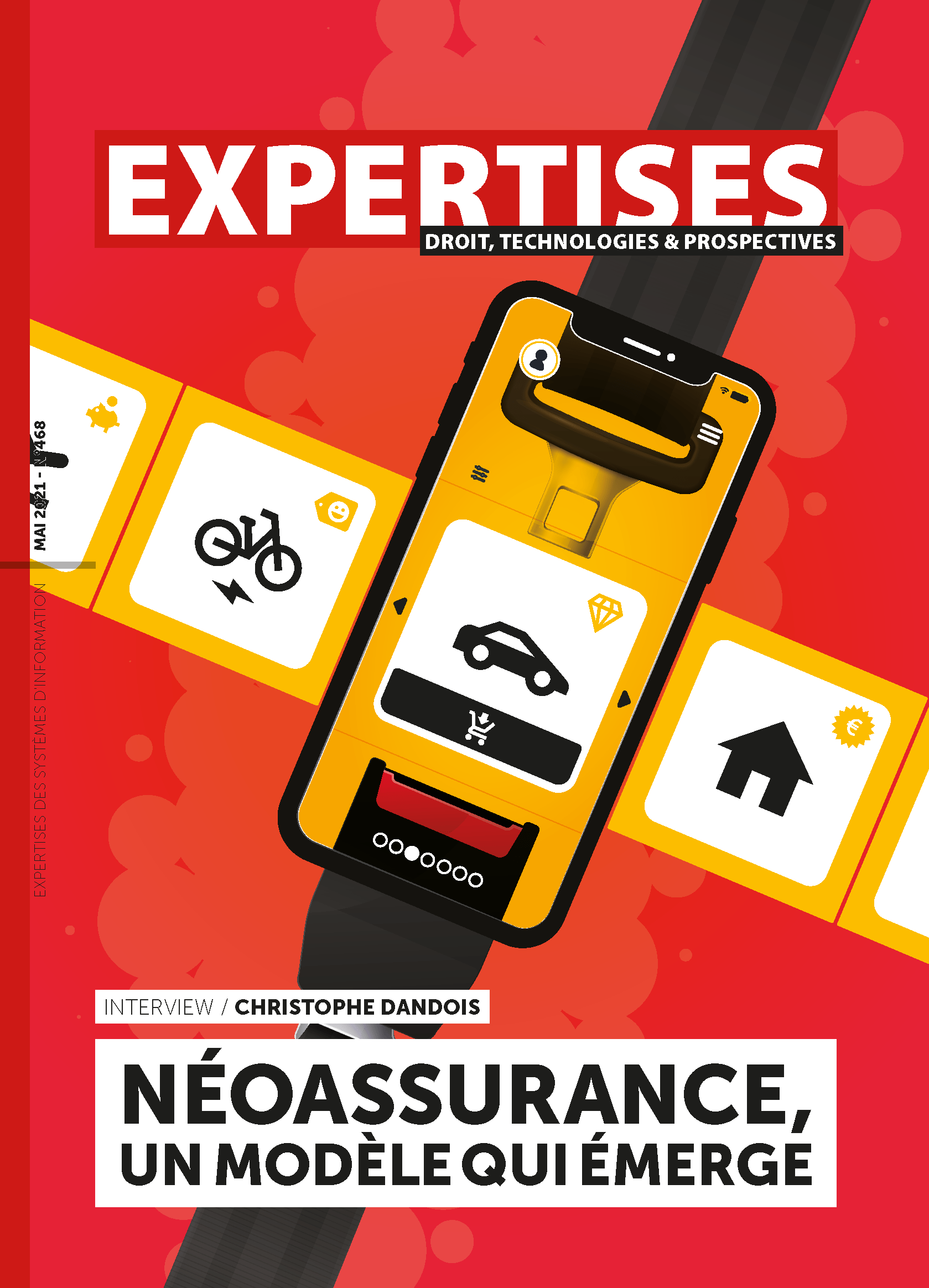
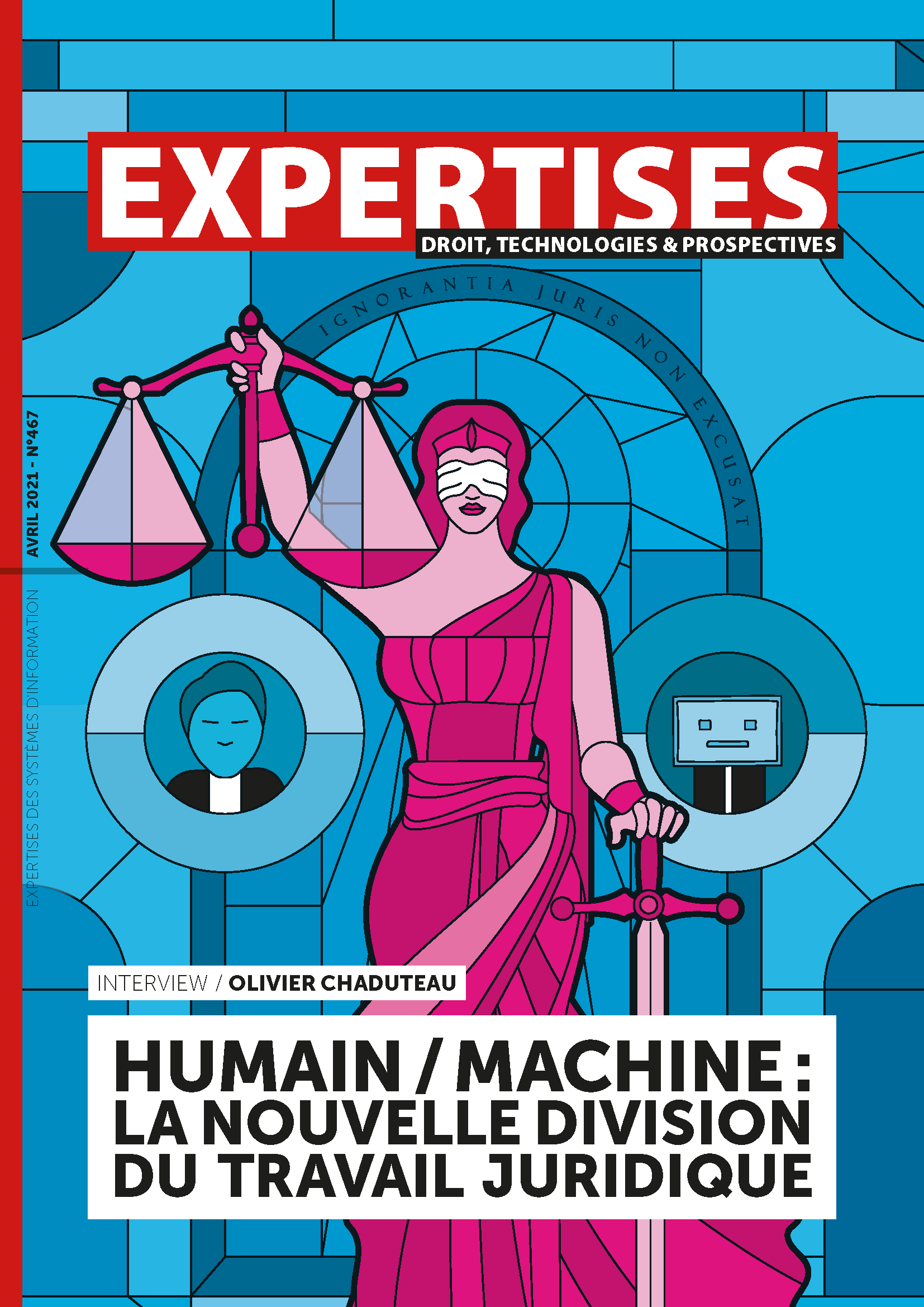

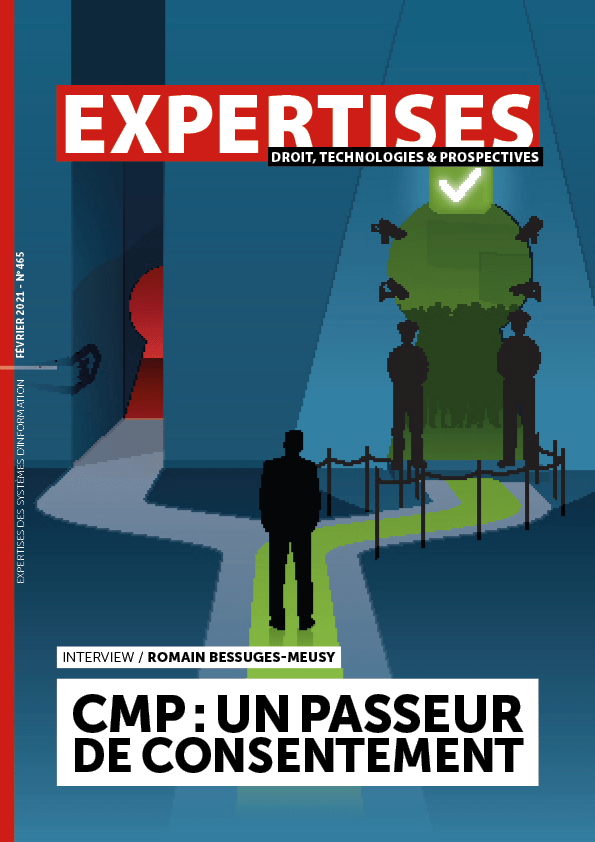
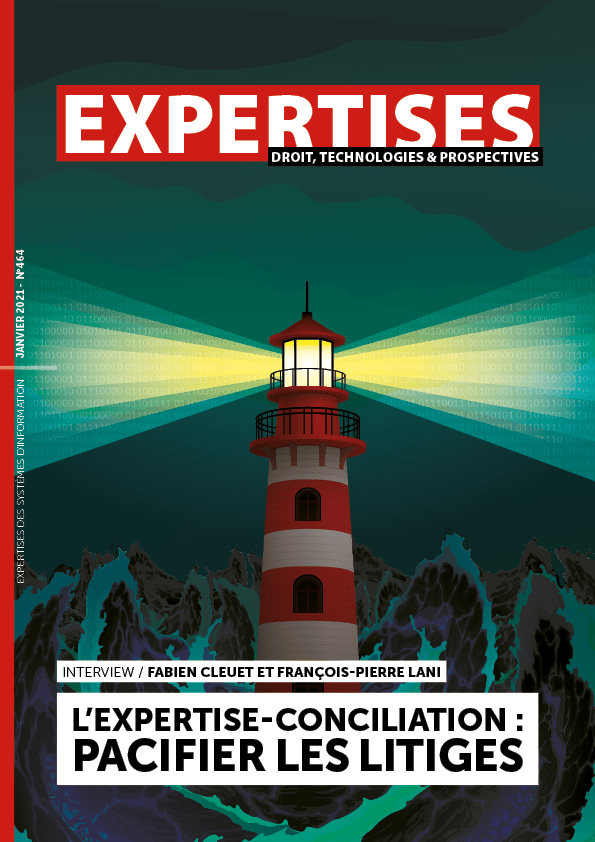
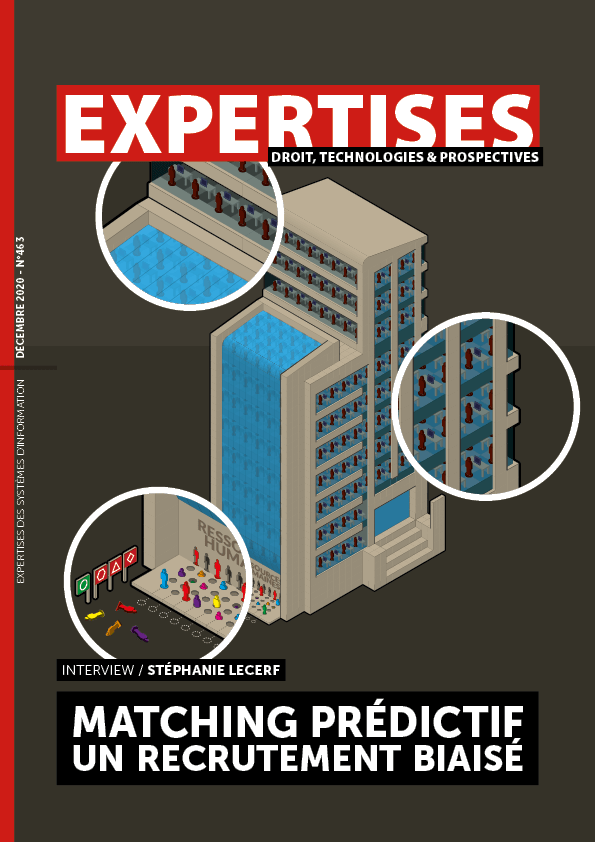
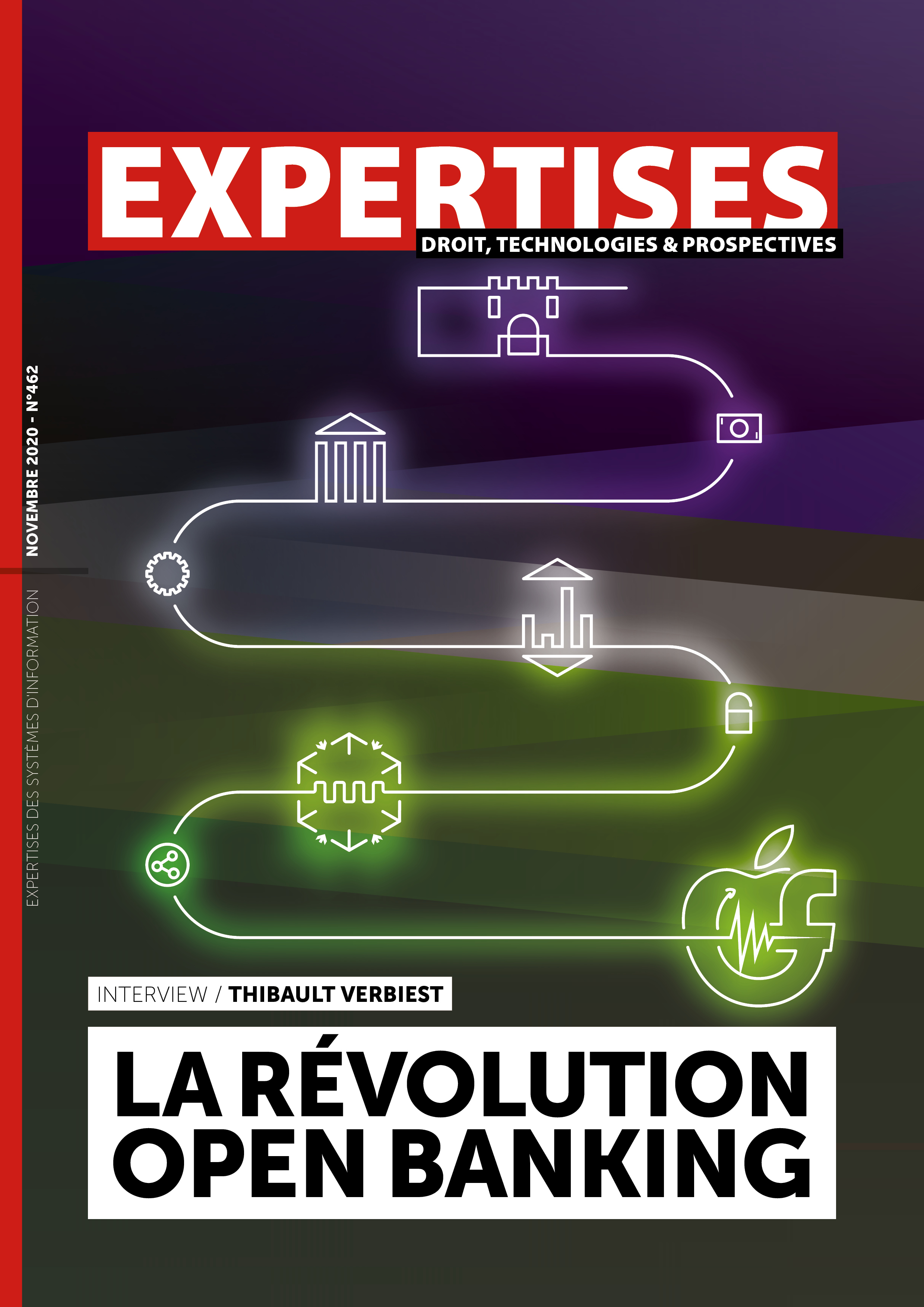

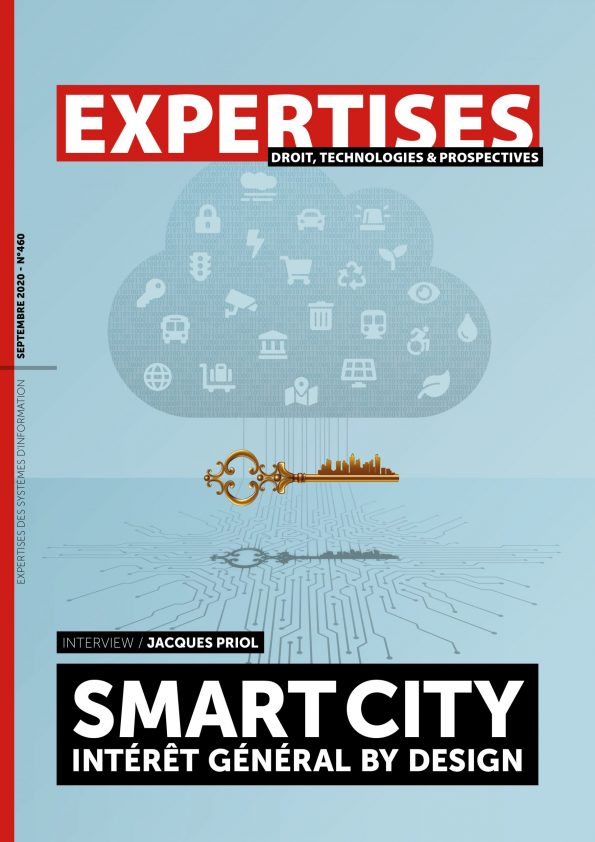
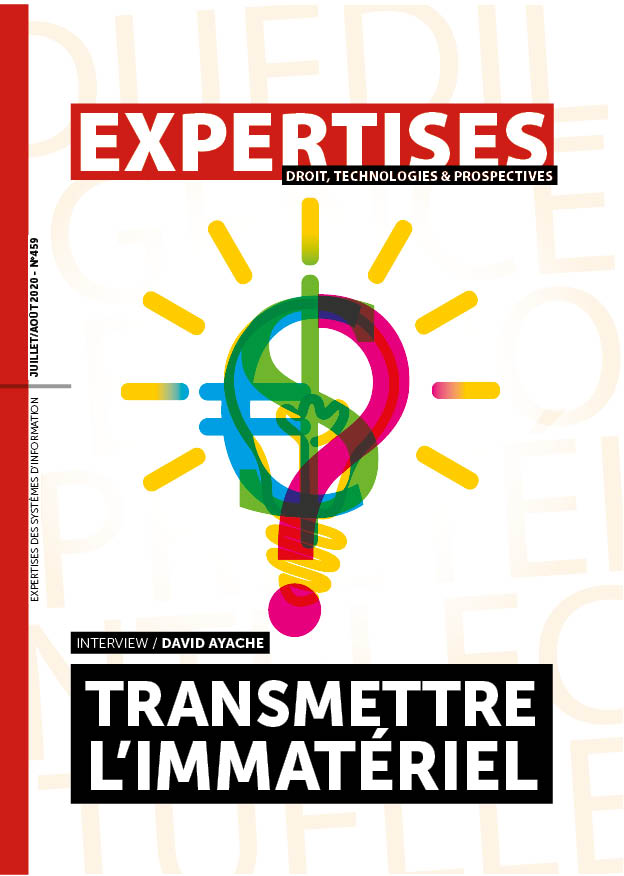
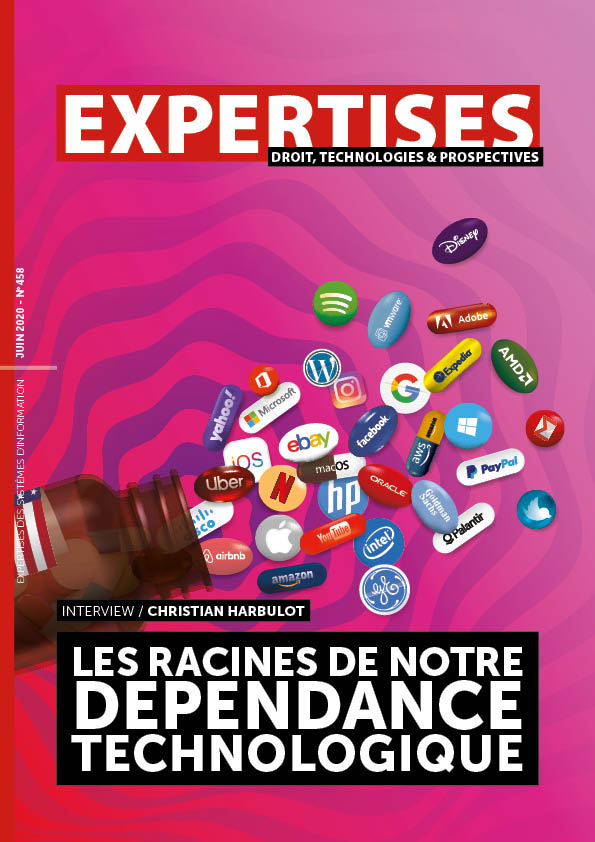
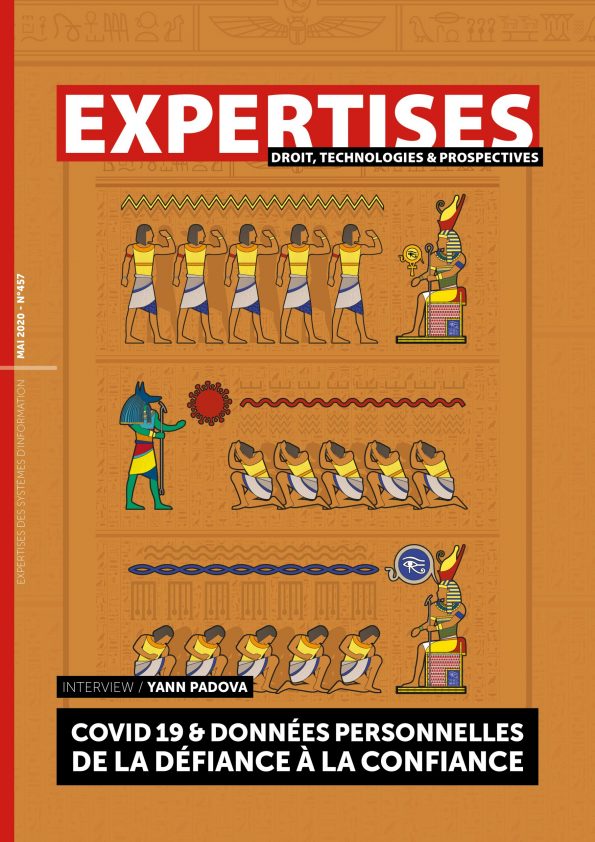 N°457 – mai 2020
N°457 – mai 2020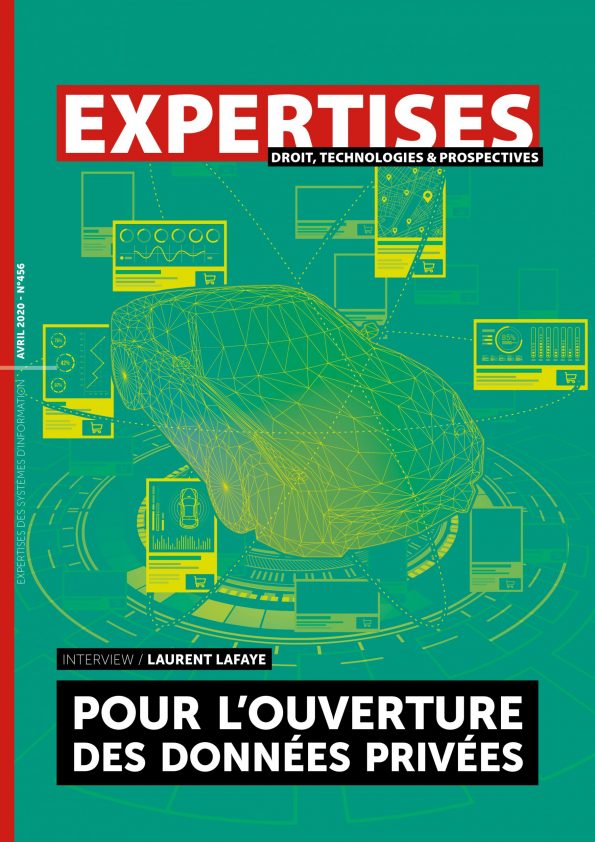 N°456 – avril 2020
N°456 – avril 2020 N°455 – mars 2020
N°455 – mars 2020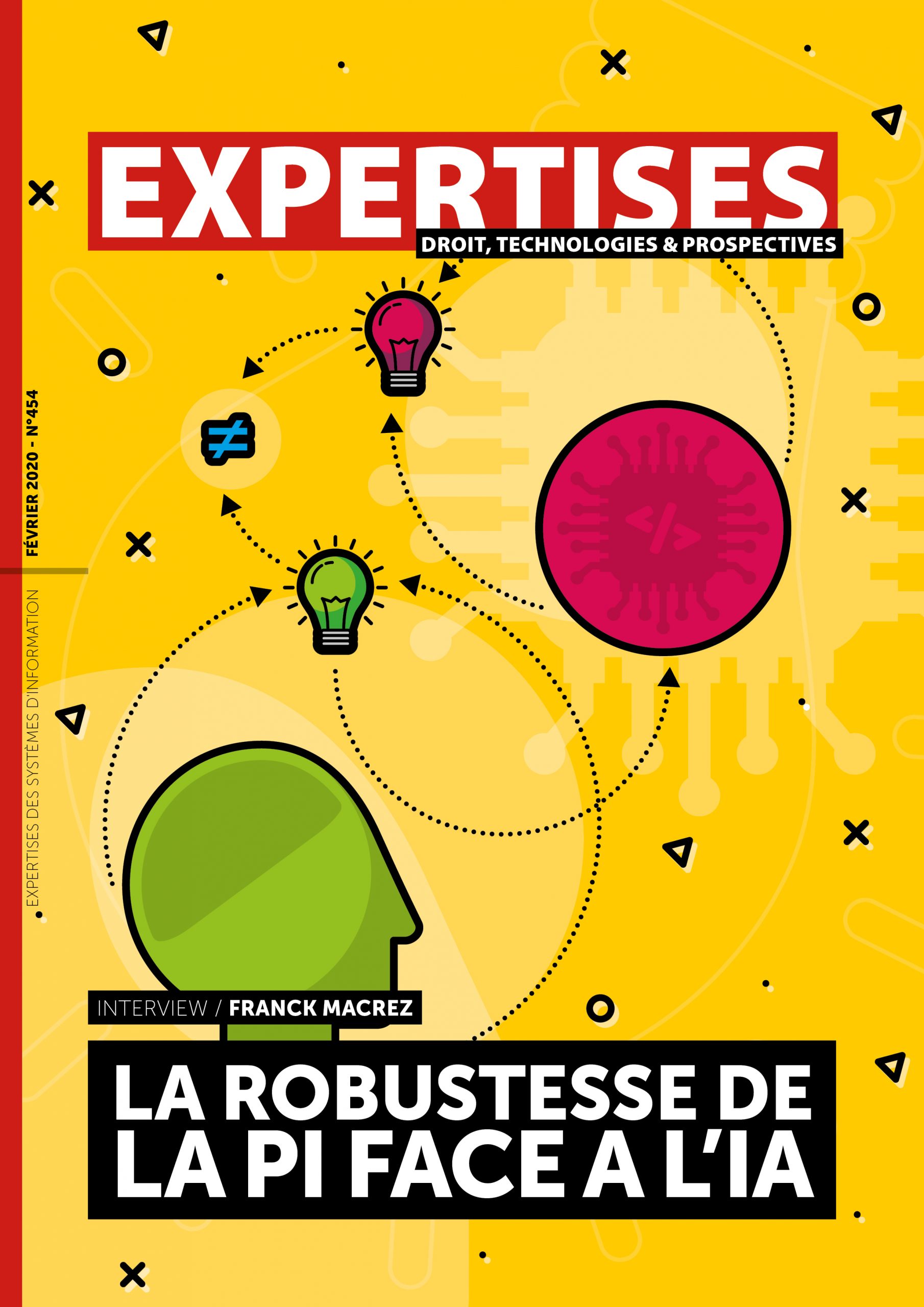 N°454 – février 2020
N°454 – février 2020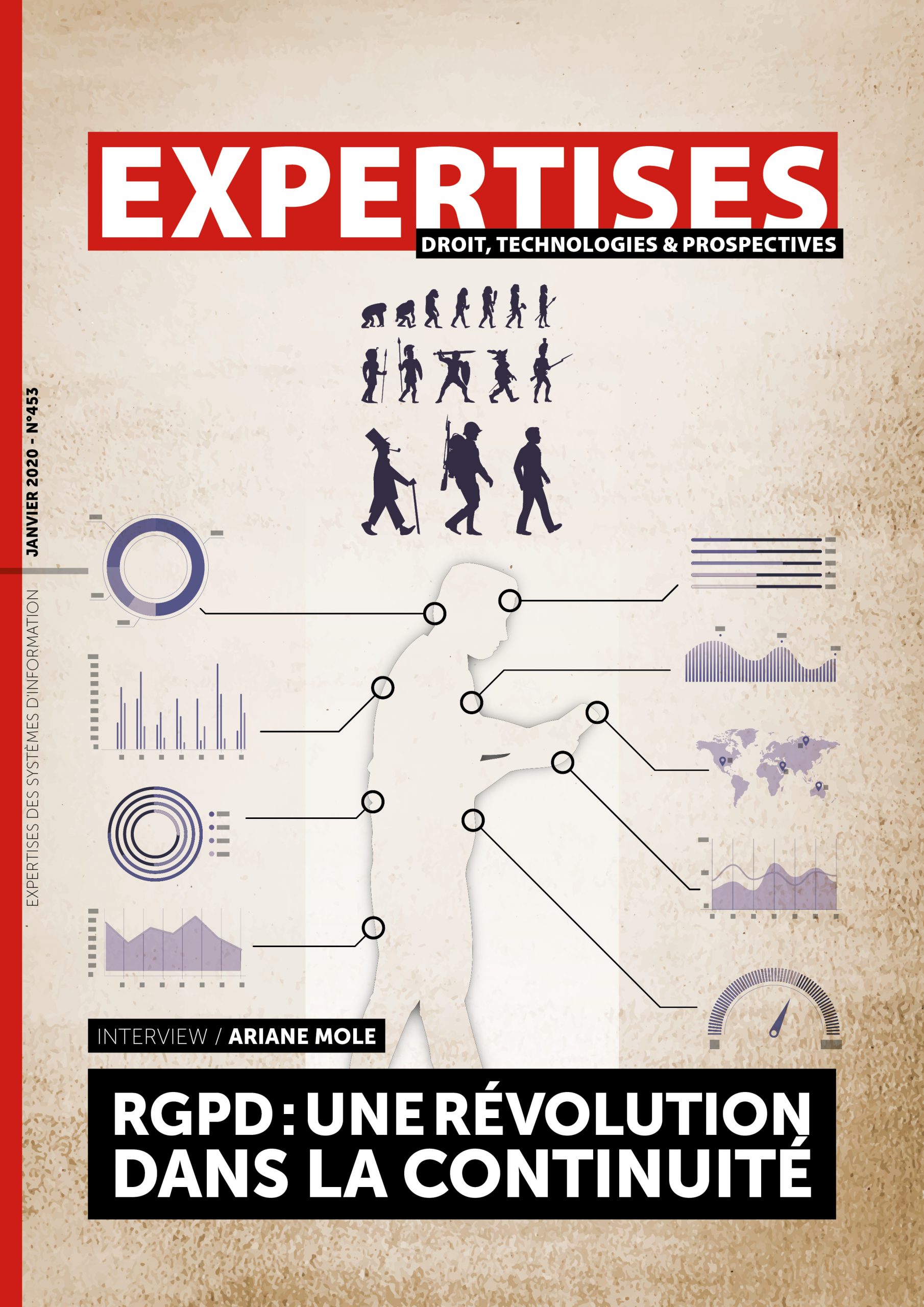
 N°452 – décembre 2019
N°452 – décembre 2019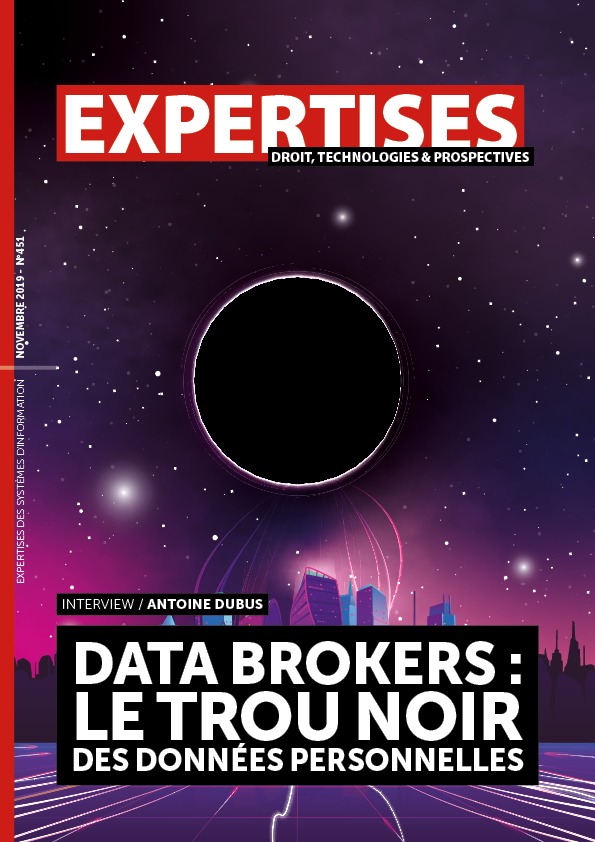 N°451 – novembre 2019
N°451 – novembre 2019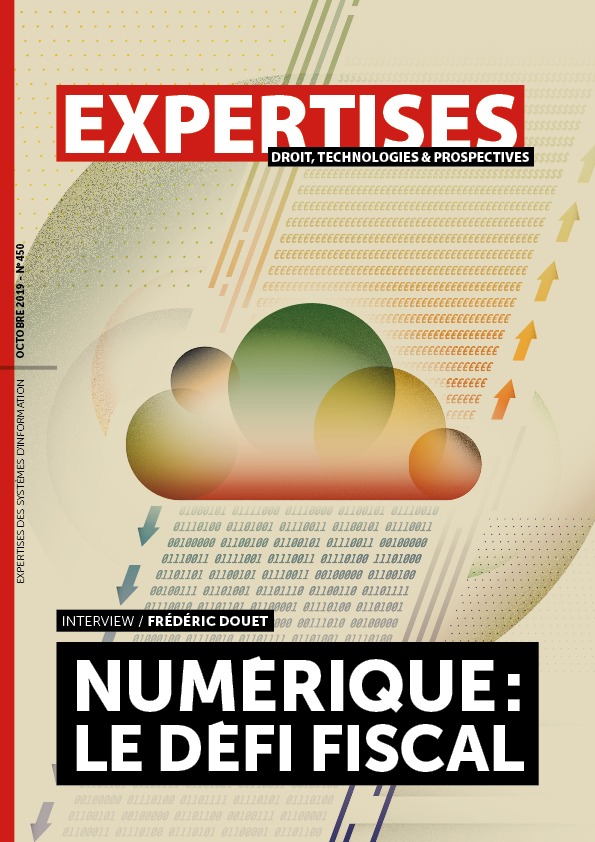 N°450 – octobre 2019
N°450 – octobre 2019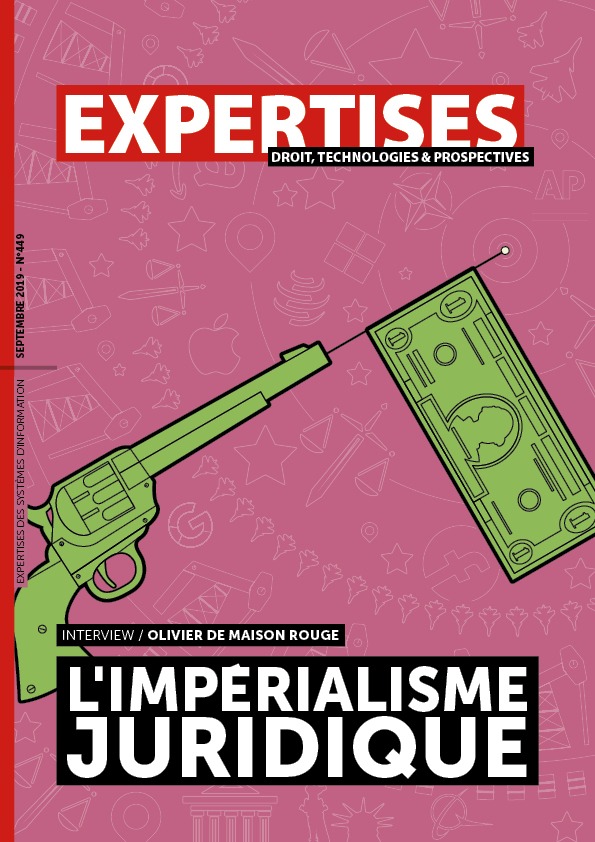 N°449 – septembre 2019
N°449 – septembre 2019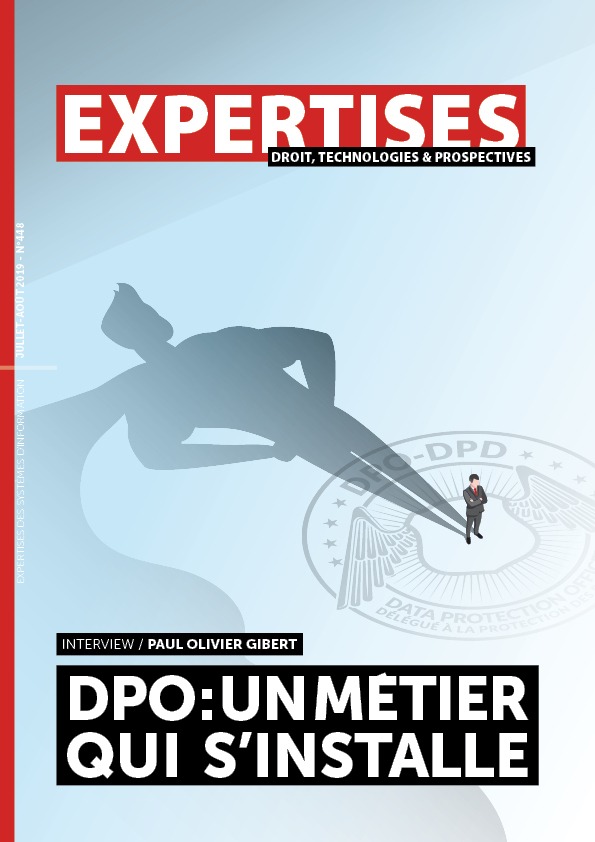 N°448 – juillet 2019
N°448 – juillet 2019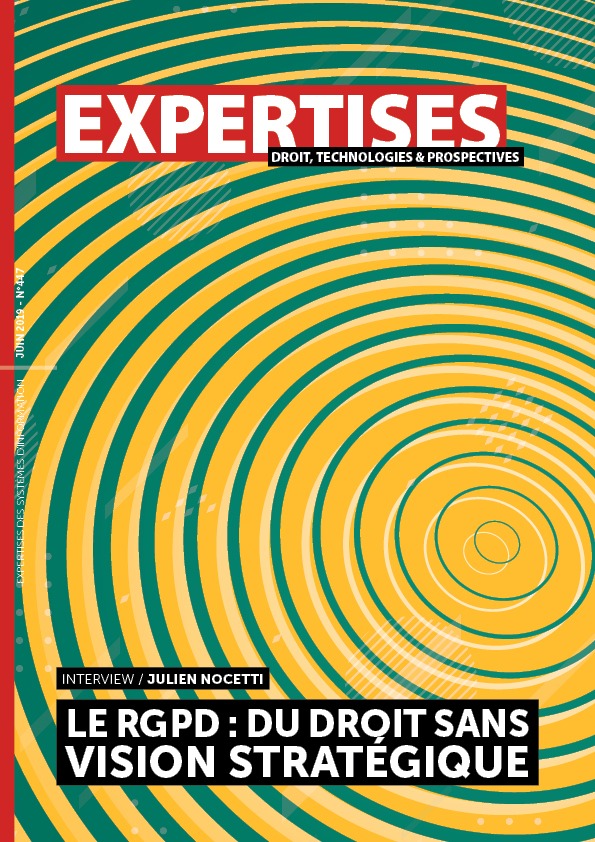

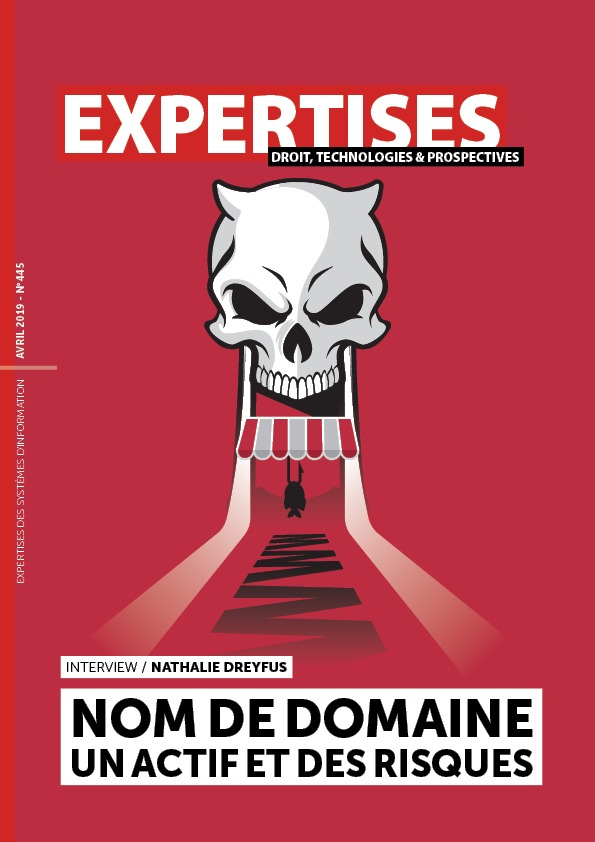
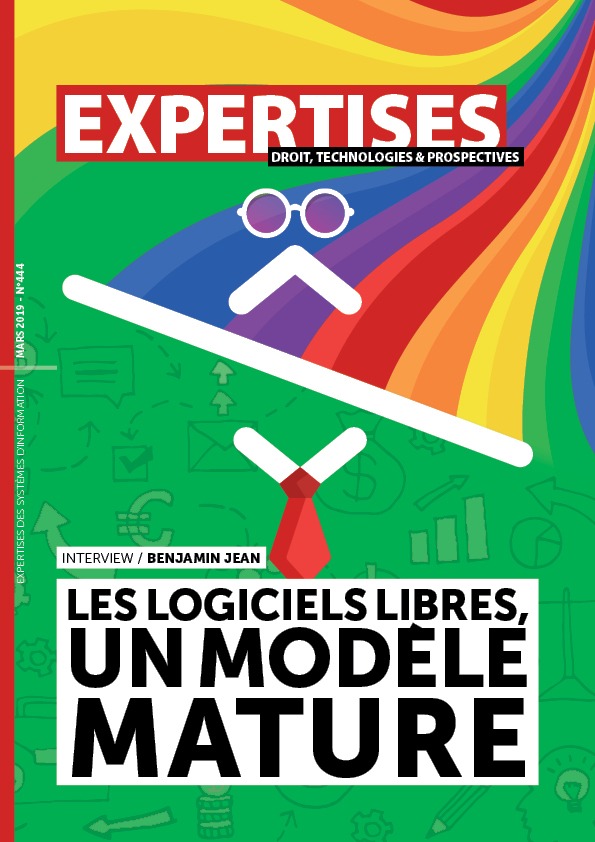

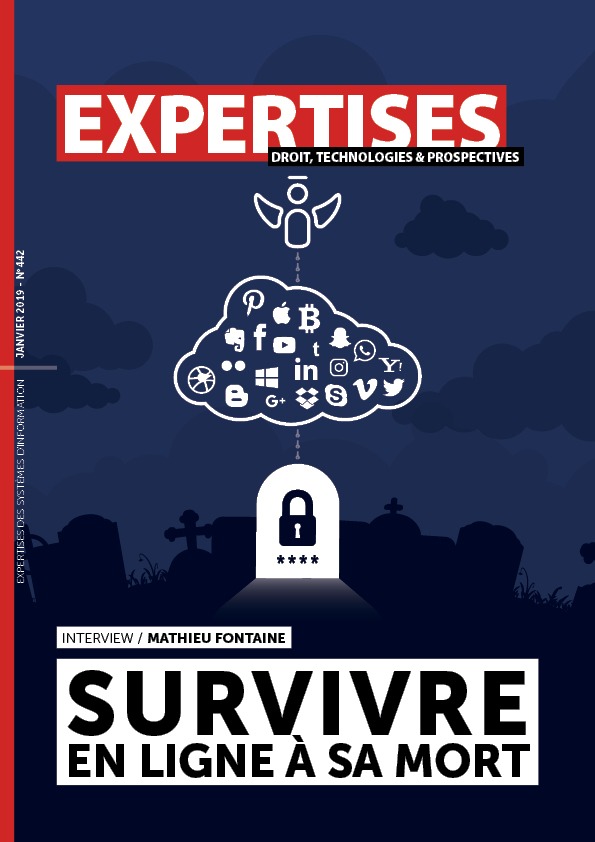

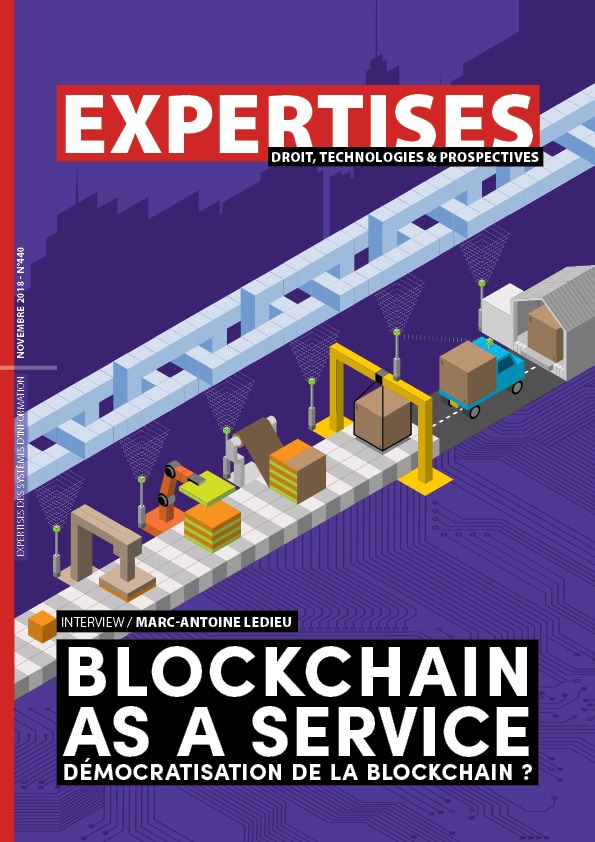

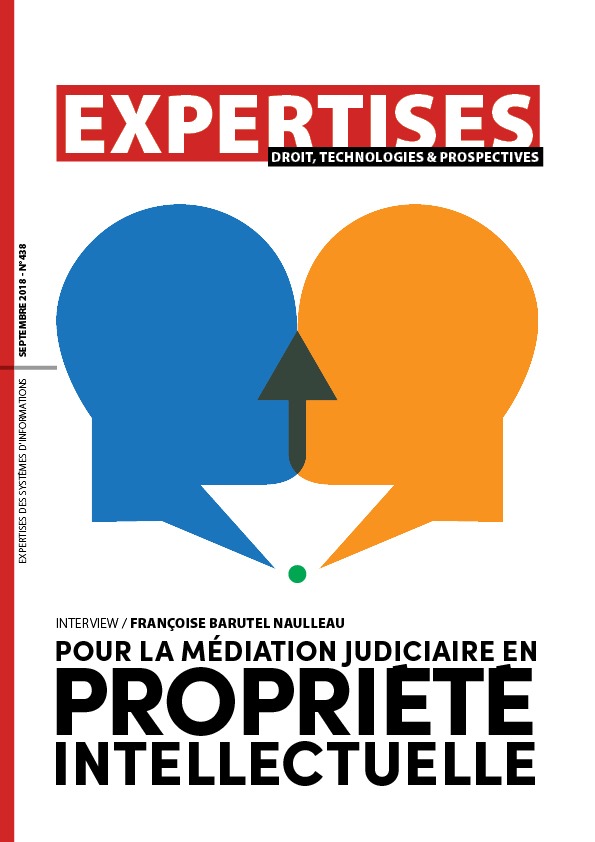
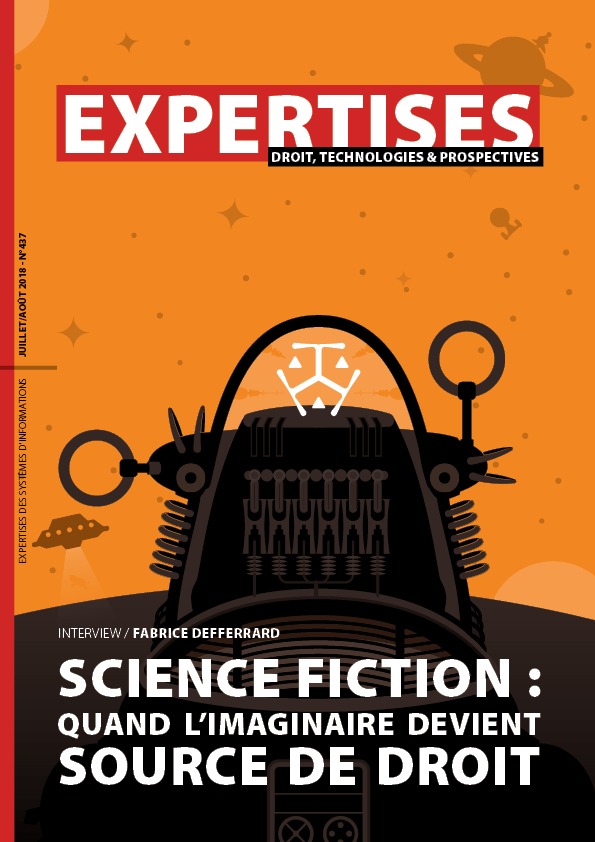
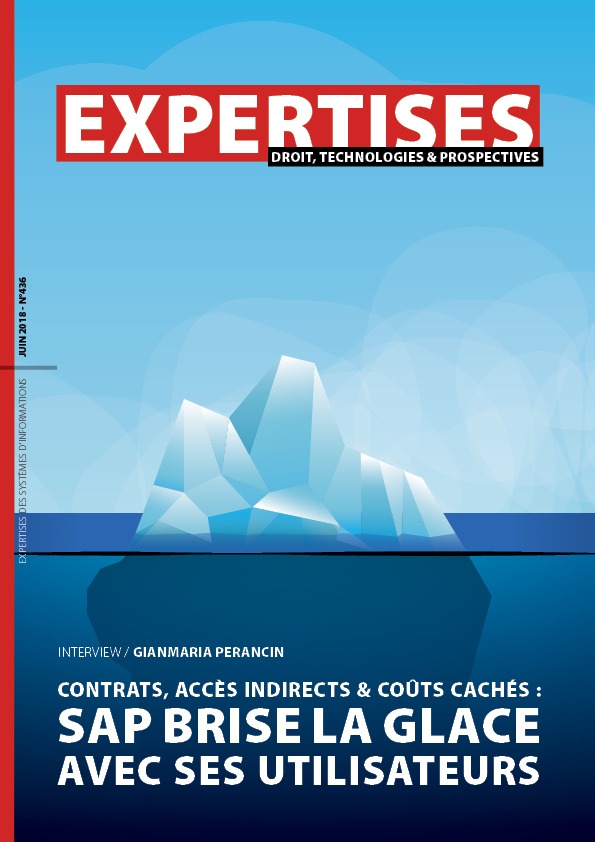

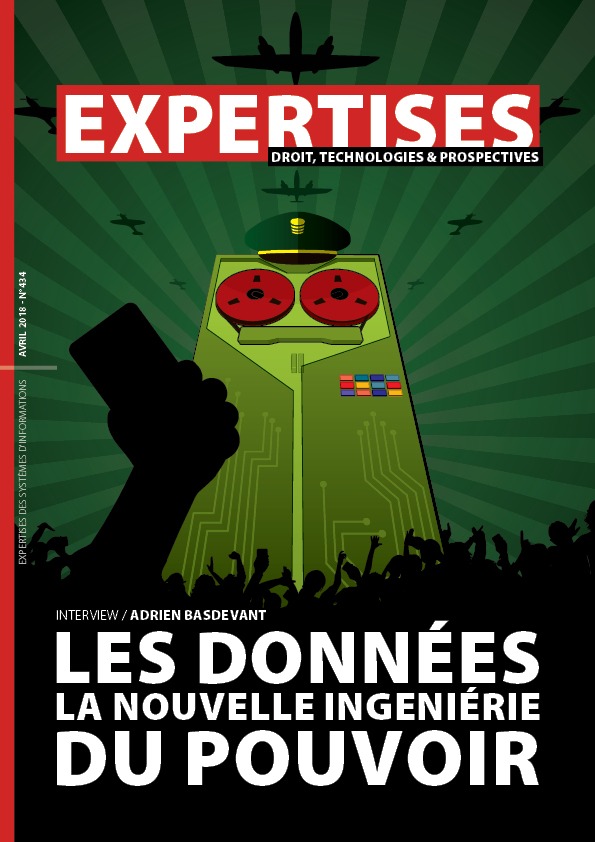
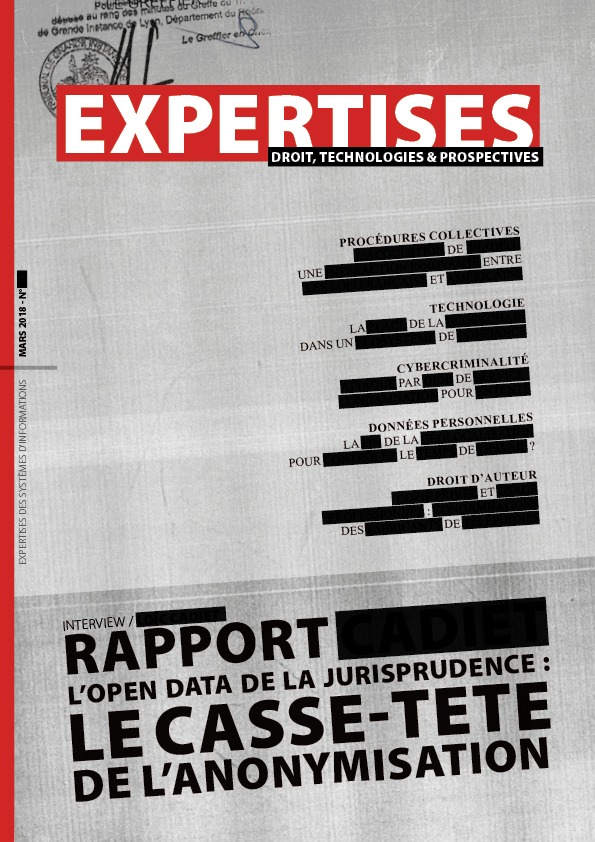



Sommaire
Edito
Focus
En bref
L’information rapide sur le monde du numérique
Magazine
L’information légale et jurisprudentielle du numérique
Interview
Doctrines
Panorama des décisions rendues en 2025 en matière de contrats IT
Panorama de la jurisprudence 2025
De Budapest à Hanoï : vers une réponse universelle contre la cybercriminalité
La responsabilité pénale dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information
Partage de données financières – L’Europe passe à la vitesse supérieure
Exploitation de l’image : contrat ou consentement ?
L'édito du mois
Test grandeur nature
Aujourd’hui, la question ne fait plus débat : les réseaux sociaux ont un impact sur la santé mentale des enfants et des adolescents. En plus d’être addictifs, ils facilitent la propagation des rumeurs et contribuent au cyber-harcèlement. Par ailleurs, les heures passées à scroller induisent d’autres effets toxiques comme les troubles du sommeil, l’anxiété, la baisse de l’estime de soi, etc. Et le phénomène est loin d’être marginal. Selon une étude récente de l’Arcom, 44 % des jeunes en France accèdent aux réseaux sociaux avant 13 ans, 25 % des 9-11 ans, d’après E-enfance. Par ailleurs, 60 % des moins de 15 ans consultent quotidiennement des réseaux de partage de photos ou vidéos, et 46 % des 11-14 ans utilisent TikTok chaque jour.
Beaucoup d’Etats dans le monde ont, semble-t-il, pris la mesure du phénomène et s’apprêtent à intervenir. L’Australie vient de frapper fort : depuis le 10 décembre dernier, l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans est interdit. La loi de 2021 sur la sécurité en ligne, amendée en novembre 2024, et qui vient d’entrer en vigueur, oblige les plateformes à vérifier que leurs utilisateurs sont âgés de 16 ans ou plus, sous peine d’amende pouvant atteindre 28 millions d’euros. Sont visés par la mesure : Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch, Thread et X.
Meta a commencé à supprimer les comptes visés par la loi. En revanche, Reddit a, dès le 12 décembre, attaqué en justice la loi australienne affirmant qu’il ne peut être considéré comme une plateforme de réseau social réservée à certains âges. Il invoque par ailleurs la liberté de communication politique et le droit, pour les électeurs, d’être bien informés. Selon la plainte, « les opinions politiques des enfants influencent les choix électoraux de nombreux électeurs actuels, notamment leurs parents et leurs enseignants, ainsi que d’autres personnes intéressées par les opinions de ceux qui atteindront bientôt l’âge de la maturité ». Ainsi, pour Reddit, « empêcher les enfants d’exprimer leurs opinions politiques pèse directement sur la communication politique en Australie ».
Les plateformes américaines demandent à Donald Trump de prendre des mesures de rétorsion contre l’Australie qui viserait injustement des entreprises américaines. Ils se trouvent que seul TikTok ne vient pas des Etats-Unis ! Malgré les menaces, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande ont déclaré vouloir suivre l’exemple australien en 2026. La Norvège et le Danemark songent à une interdiction avant l’âge de 15 ans. En France, Emmanuel Macron s’est prononcé dans ce sens et le 18 novembre dernier de très nombreux députés dont Gabriel Attal ont déposé une proposition de loi, qui doit être discutée le 19 janvier prochain, et qui prévoit l’interdiction de l’accès aux moins de 15 ans, la suspension des comptes déjà existants et un « couvre‑feu numérique » pour les mineurs entre 15 et 18 ans. Le 26 novembre dernier, le Parlement européen, de son côté, a adopté en session plénière une résolution non contraignante appelant à fixer à 16 ans l’âge minimum harmonisé dans l’Union européenne pour accéder aux réseaux sociaux
Les plateformes font valoir l’impossibilité technique de vérifier l’âge réel de leurs utilisateurs. A n’en pas douter, l’Australie avec sa loi pionnière constitue un laboratoire grandeur nature sur la faisabilité d’une telle interdiction. Et ses résultats vont être scrutés de près. Plusieurs plateformes ont annoncé qu’elles recourraient à l’IA pour estimer l’âge des internautes à partir de leurs photos. Ceux-ci pourraient aussi avoir à transmettre un document d’identité. Plus fiable apparaît le système de double identification, via un site qui délivre un certificat préconisé par la Cnil ou l’Arcom (voir l’interview).
Aucune solution n’est parfaite et l’interdiction n’est peut-être pas la mesure idéale car les réseaux remplissent aussi une fonction sociale en permettant entre autres aux jeunes de se sentir appartenir à un groupe, d’être reconnus, de s’exprimer. Mais les Etats se doivent d’agir pour protéger leur jeunesse, même si la méthode est contournable ou faillible.
Le focus du mois
Etats-Unis : offensive fédérale contre les lois étatiques
Donald Trump a signé un décret contre les lois sur l’IA des Etats fédérés accusés de freiner l’innovation et de pénaliser les Etats-Unis face à la Chine. Un texte controversé outre-Atlantique.

Le secteur américain de l’IA s’oppose à toute règlementation qui pourrait entraver son développement. Mais l’Europe et son IA Act n’est pas le seul terrain de bataille. Aux Etats-Unis, ce sont les Etats fédérés qui constituent la cible des pro-IA défenseurs d’un cadre légal minimal. Faute d’avoir pu faire voter par le Congrès américain une disposition qui empêche les Etats de légiférer sur l’IA, Donald Trump est passé par la voie règlementaire. Le 11 décembre dernier, il a signé un décret (executive order) intitulé « établir un cadre politique national pour l’intelligence artificielle » visant à bloquer toute législation encadrant l’intelligence artificielle et à empêcher les États de réglementer cette technologie émergente. Evidemment le secteur de l’IA s’est félicité d’une telle mesure dont il est à l’origine mais qui suscite une forte désapprobation, y compris parmi les Républicains. Se pose cependant la question de la constitutionnalité du décret.
« Il ne doit y avoir qu’un seul règlement si nous voulons continuer à être les premiers dans le domaine de l’IA (…), a écrit Donald Trump, le 8 décembre dernier sur son réseau Truth Social, annonçant la signature de ce futur texte. « On ne peut pas exiger d’une entreprise qu’elle obtienne 50 autorisations à chaque fois qu’elle veut faire quelque chose (…). À ce stade de la course, nous sommes en tête face à TOUS LES PAYS, mais cela ne durera pas si 50 États, dont beaucoup sont des acteurs malveillants, sont impliqués dans les RÈGLES et le PROCESSUS D’APPROBATION ».
En novembre 2025, 38 États américains, plutôt Démocrates mais aussi Républicains, avaient en effet adopté plus d’une centaine de lois relatives à l’IA, ciblant principalement les deepfakes, la transparence et la divulgation, ainsi que l’utilisation de l’IA par les pouvoirs publics. Les Etats ont ainsi compensé l’absence de texte fédéral sur une technologie qui inquiète la population en l’absence de protection. Le Congrès n’est en effet jamais parvenu à adopter un texte sur le sujet malgré l’élaboration de dizaines de projets de lois. Et pour cause, l’industrie de la tech n’en veut pas. Cela fait des années que la Silicon Valley milite contre toute réglementation en la matière, notamment par le biais de comités d’action politique (political action committee ou PAC) pro-IA dont celui financé par Andreessen Horowitz, Greg Brockman (cofondateur d’OpenAI) et Joe Lonsdale (cofondateur de Palantir).
Pour mettre un terme à ce patchwork législatif, l’administration américaine a d’abord tenté la voie législative. La Chambre des représentants a introduit une disposition pour un moratoire sur les lois étatiques relatives à l’IA dans le projet de loi de financement de la défense nationale (NDAA). Mais cette tentative a rencontré une forte opposition des membres du Congrès. Deux cents parlementaires (Démocrates et Républicains) ont signé une lettre ouverte contre l’introduction du moratoire prévu dans la loi NDAA. Ils concluent qu’« après des années sans action fédérale globale sur la vie privée et les préjudices causés par les médias sociaux, une large préemption des lois étatiques et locales sur l’IA jusqu’à ce que le Congrès agisse retarderait les progrès et saperaient les protections existantes. Nous vous demandons respectueusement de rejeter toute disposition qui prévaudrait sur la législation étatique et locale en matière d’IA dans la NDAA de cette année et de soutenir l’élaboration, plutôt que le démantèlement, d’une politique responsable en matière d’IA ». Parallèlement, trente-six procureurs généraux d’Etat ont également signé une lettre ouverte déclarant que « l’IA va bouleverser notre sécurité publique, notre sécurité nationale, notre économie et notre santé, et les États-Unis doivent se préparer à jouer un rôle de leader international. Ce moratoire nous mettrait en retard en liant les mains des États et en ne suivant pas le rythme de l’évolution technologique. Nous demandons donc au Congrès de ne pas inclure de moratoire sur l’IA dans la prochaine loi ».
Finalement, le Congrès a voté massivement contre cette disposition (99 / 1), ce qui n’a pas freiné la détermination de Donald Trump qui est passé par une autre voie. Le décret n’interdit pas aux Etats d’adopter des lois sur l’IA et il n’établit aucune norme fédérale en matière d’IA. Comme l’a précisé lors de la cérémonie de signature du décret David Sacks, baptisé « le tsar de la Maison Blanche en matière de cryptomonnaies et d’IA » et qui a l’oreille de Donald Trump, le décret présidentiel permettrait à l’administration de créer un « cadre fédéral » sur l’IA en collaboration avec le Congrès qui interdirait les lois des États qui entrent en conflit avec le décret, mais garantirait les dispositions sur « la protection des enfants, la prévention de la censure, le respect des droits d’auteur et la protection des communautés ». Le décret charge par ailleurs la Procureure générale Pam Bondi de créer dans un délai de 30 jours un « groupe de travail sur les litiges en matière d’IA » afin de contester les lois étatiques qui seraient jugées inconstitutionnelles au regard des règles sur le commerce interétatique. Par ailleurs, le secrétaire au Commerce devra identifier et évaluer les lois étatiques existantes qui sont en conflit avec le décret. Il devra aussi publier dans un délai de 90 jours une note de politique générale décrivant les conditions d’admissibilité des Etats pour recevoir le reste des fonds du programme Broadband Equity, Access and Deployment afin d’étendre l’accès à l’internet haut débit.
Ce texte a été applaudi par la plupart des représentants de la tech mais il a parallèlement provoqué un tollé parmi les défenseurs des libertés et des consommateurs mais aussi des membres du Congrès. En dehors des arguments politiques, se pose la question de la validité d’un tel décret, notamment au regard de la Constitution. Il aurait notamment pour effet de réduire l’éventualité d’une action du Congrès et pourrait violer le 10e amendement, qui stipule que tous les pouvoirs non expressément attribués au gouvernement fédéral appartiennent aux États ou au peuple. Et puis, il pourrait également être considéré comme anticonstitutionnel le fait de modifier unilatéralement et rétroactivement les conditions d’octroi des subventions fédérales aux États.
Ce décret a de fortes probabilités d’être contesté devant les tribunaux et invalidé. Mais en dernier ressort, il restera à la Cour suprême, majoritairement républicaine, de se prononcer.
L'invité du mois
Interview / Thibault du Manoir de Juaye
Manipulation sur les réseaux sociaux – Les limites du droit
La manipulation mentale n’est pas propre aux réseaux sociaux mais ils facilitent sa diffusion au point de représenter un danger pour les personnes et les sociétés. Aujourd’hui, la protection des mineurs fait l’objet d’une préoccupation particulière. L’Australie est en train de mettre en œuvre l’interdiction des réseaux aux mineurs, Emmanuel Macron veut l’instaurer en France, le Parlement européen la réclame, la Chine en contrôle l’accès, les procès se multiplient aux Etats-Unis. La manipulation de l’information est également une grande source d’inquiétude. Pour lutter contre ces dérives, le droit est une arme indispensable mais pas suffisante, comme le rappelle Thibault du Manoir de Juaye qui vient de publier un ouvrage sur le sujet et qui évoque avec nous les facettes du problème.

Sylvie Rozenfeld : Thibault du Manoir de Juaye, vous êtes avocat, et vous venez de publier un ouvrage sur la réponse du droit à la manipulation sur les réseaux sociaux (*). Une publication qui intervient au moment où ces plateformes sont particulièrement au centre de l’actualité en France, en Europe et aux Etats-Unis.
C’est l’occasion de faire le point sur les nombreuses armes juridiques qui existent pour lutter contre les manipulations de l’information, des personnes, des organisations mais aussi des Etats qui sévissent sur les réseaux sociaux mais aussi de mesurer leur efficacité. Pourquoi avoir choisi d’écrire un livre sur ce sujet ?
Thibault du Manoir de Juaye : Le premier ouvrage que j’ai publié portait sur l’intelligence économique qui comporte trois volets : la captation d’information, la protection de l’information ainsi que l’influence et la contre-influence. Aujourd’hui, on ne parle plus d’influence ou de contre-influence mais de désinformation ou de manipulation.
En 2007, j’avais déjà évoqué ce problème de désinformation mais avec les réseaux sociaux le phénomène s’est transformé en manipulation qui ne touche pas que les Etats et les entreprises mais aussi les individus. Comme tout le monde, je suis confronté aux réseaux sociaux et face à l’actualité, il n’est pas possible de rester insensible à l’action des réseaux sociaux. Il y a par ailleurs des affaires emblématiques pour moi, comme celles de Mila, de Cambridge Analytica ou les MacronLeaks qui sont beaucoup plus politiques. Puis, on a vu apparaître la problématique de l’emprise mentale à laquelle Emmanuel Macron veut s’attaquer dans ses dernières propositions en protégeant les mineurs des méfaits des réseaux sociaux.
Le champ des textes que vous avez sélectionné est très large : cyberharcèlement, diffamation, dérives sectaires, contrefaçon, fausses informations, apo-
logie du terrorisme, atteinte aux mineurs, etc.
Comment définir le phénomène de la manipulation d’un point de vue psychologique, car c’est toujours psychologique, n’est-ce pas ?
La manipulation est très proche de l’influence qui comporte deux facettes : le nudge et le sludge. Le nudge peut se définir comme l’influence douce. Si je dis que vous êtes quelqu’un de sympathique, c’est une forme de manipulation pour attirer votre sympathie. Comme cet exemple souvent cité : un café aurait mis des cendriers sur son bar car tout le monde jetait ses mégots par terre. Mais personne ne les utilisait. Alors il a eu l’idée de mettre des cendriers sur lesquels figuraient des images de footballers en demandant de voter pour leur préféré en y jetant leurs mégots. Et les clients l’ont fait.
C’est une forme d’influence qui a été théorisée par Richard Thaler. Il a montré que les individus ne se comportent pas comme des agents parfaitement rationnels, mais sont influencés par des biais cognitifs, l’émotion et le contexte dans lequel les options leur sont présentées. Il a eu le prix Nobel pour ses recherches. Le sludge consiste en une manipulation plus ou moins cachée, une influence négative, avec des cas extrêmes comme la pédophilie sur internet où une personne va demander à un enfant d’envoyer des photos dénudées pour l’entraîner beaucoup plus loin.
Selon moi, la manipulation, c’est l’influence soft à la manipulation à des fins perverses. Et c’est ce que j’ai traité à travers toutes les branches du droit.
Y-a-t-il une définition légale française
ou européenne de la manipulation ?
J’ai fait des recherches et je n’ai trouvé aucune définition légale de la manipulation, à part un arrêt de la cour d’appel de Paris de chambre sociale. Il s’agissait d’un salarié qui s’était fait manipuler dans le cadre d’une arnaque au président. La cour d’appel de Paris dans une décision du 11 janvier 2023 a décrit les mécanismes de manipulation en ses termes « Les techniques employées par les fraudeurs sont ceux de la manipulation mentale consistant à créer une relation privilégiée avec l’interlocuteur en mettant en avant ses éminentes qualités, à couper tous liens avec les relations extérieures, en mettant en avant la confidentialité, en exerçant une pression en invoquant une urgence, créatrice de stress, et en mettant en place des éléments de sérieux pour éviter tout doute. ».
Le droit connaît depuis longtemps les phénomènes de manipulation. Par exemple, nous avons le dol en droit civil et son pendant pénal qui est l’escroquerie. Par ailleurs, en matière d’influence, nous avons les notions de provocation à commettre un crime ou à la haine raciale qui figurent dans la loi de 1881. J’ai donc décomposé dans mon ouvrage tous les éléments du droit qui pourraient s’appliquer à une manipulation tot…
Les doctrines du mois
Panorama des décisions rendues en 2025 en matière de contrats IT
Etude des décisions rendues par les juridictions françaises en 2025 en matière de projets digitaux. Quel impact sur les pratiques contractuelles et (pré)contentieuses ?
Panorama de la jurisprudence 2025
L’année 2025 a vu, sans surprise, le contentieux signature électronique s’étoffer. Non seulement les décisions sont plus nombreuses, mais elles portent sur des secteurs plus variés comprenant notamment le leasing B to B, qui semblait jusqu’ici épargné. Corrélativement, les juges se sont montrés plus enclins en 2025 à refuser les signatures électroniques, fournissant d’intéressants enseignements sur la fiabilisation des parcours et l’amélioration des dossiers produits.
De Budapest à Hanoï : vers une réponse universelle contre la cybercriminalité
Le cyberespace, par son absence de frontières, offre aux criminels un terrain de jeu illimité, rendant la coopération internationale une nécessité absolue. Le combat contre la cybercriminalité se joue sur la capacité des États à harmoniser leurs lois et à échanger rapidement des preuves numériques. Si la Convention de Budapest (2001) a longtemps servi de référence, l'ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (dite "Convention de Hanoï") en octobre 2025 marque l'ambition d'un cadre véritablement universel.
La responsabilité pénale dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information
Si la fonction de responsable de la sécurité numérique n’est pas spécifiquement encadrée, ce dernier est soumis à des obligations juridiques dont les obligations de sécurité et de conformité. Sa responsabilité pénale peut être engagée mais il faut cependant distinguer le régime de responsabilité pénale applicable au dirigeant de l’entreprise et celui applicable au responsable de la sécurité numérique.
Partage de données financières – L’Europe passe à la vitesse supérieure
L’UE s’apprête à franchir une nouvelle étape dans l’ouverture des données financières avec le règlement FiDA. Inspiré de l’open banking, ce texte vise à instaurer un cadre commun d’open finance permettant aux consommateurs et aux entreprises de partager leurs données bancaires, assurantielles ou d’investissement avec des prestataires tiers agréés. FiDA, actuellement en discussion entre le Parlement et le Conseil, prévoit un système d’accès strictement encadré - consentement explicite, gouvernance sectorielle, supervision renforcée. Son entrée en application sera progressive et devrait intervenir entre 2027 et 2028.
Exploitation de l’image : contrat ou consentement ?
Comme chaque mois, Alexandre Fievée sélectionne une décision sur la protection des données personnelles rendue par une autorité de contrôle ou une juridiction étrangère. Ce mois-ci, il se penche sur la question de la base légale de l’exploitation de l’image d’une personne dans le cadre d’entretiens vidéo destinés à être publiés sur les réseaux sociaux.
Tous les mois, toute l'actualité du numérique... Et tellement plus !
FORMULES D'ABONNEMENT